

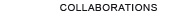


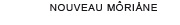


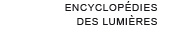
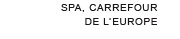
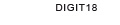
|
|
E-bibliothèque > Articles
Turneps, forts-bœufs
et
grosses charrues :
l’agriculture dans l’Esprit
des journaux*

Par MURIEL COLLART
Poste d’observation de la vie de son temps, organe de répercussion de l’information destiné au lecteur avide d’être éclairé sur les enjeux de son époque, l’Esprit des journaux laisse peu de domaines de l’actualité et du savoir en friche, et certainement pas l’agriculture.
Un défi auquel se trouva confronté le 18e siècle fut la nutrition d’une population en forte croissance démographique. En France, dans le cadre des frontières actuelles, le nombre d’habitants passa, de 20 millions en 1700 à 29,1 millions en 1790[1] (45,5 %). Cette augmentation conduisit à s’interroger sur les cultures à favoriser et sur les façons de les produire.
En un siècle, 1 214 livres d’agronomie sortiront de presse contre 130 au 17e siècle[2]. Entre 1745 et 1789, 21 journaux spécialisés en « économie et agriculture » seront lancés[3]. Les sociétés d’agriculture se créeront à partir de 1757[4]. Elles offrent à des mémoires innovants des prix tels que la rétrocession d’une fraction de la dîme[5] ou l’attribution de médailles d’or de poids variables[6]. Elles rendent aussi des « avis d’expertise » qui consistent par exemple à certifier que telle charge de foin ne contient nulle trace de rats ou de souris[7]… Les académies participent à cet intérêt pour la chose agricole en mettant également au concours des mémoires sur des questions quelquefois appelées « sujets de physique » ou « de physique rurale ». L’essor est évidemment encouragé, à la fin des années 1750, par le mouvement physiocratique pour lequel les produits de la terre constituent la seule richesse d’un pays. Les principes et tendances agronomiques définissant une « philosophie de la ferme » sont posés : extension des surfaces cultivables (abandon de la jachère, développement des prairies artificielles, assèchement des zones humides), introduction de cultures alternatives (céréales, pommes de terre, maïs), modification des modes de production (bestiaux, engrais, outillage), accroissement des cultures industrielles (chanvre, lin, mûrier), développement de l’élevage (bêtes à laine, bêtes à cornes).
L’Esprit des journaux se révéla un puissant relais de diffusion de cette agriculture nouvelle dont l’émergence se manifeste dans des épîtres et fables relatives au monde rural autant que dans des recensions et extraits d’ouvrages spécialisés. Les rubriques « Mélanges » et « Poésies fugitives » évoquent les caractères ou problèmes de la vie paysanne, celle des « Académies et sociétés diverses » prodigue, avec les comptes rendus d’activité des sociétés d’agriculture, conseils, questions et témoignages. Parmi les « Traits de bienfaisance » se multiplient les relations de mesures charitables en faveur du monde rural. La « Bibliographie de l’Europe » et le « Catalogue des livres nouveaux » enregistrent des préoccupations qui traversent l’Esprit des journaux de part en part et apparaissent aussi dans des rubriques où on ne les attend pas, par exemple dans la catégorie « Médecine », où le journal, fervent partisan de la pomme de terre, présente celle-ci comme un remède aux brûlures de la peau[8].
Quelle image cette littérature renvoie-t-elle d’abord : celle d’un secteur en pleine réforme structurelle ou celle d’un savoir tentant d’avancer vaille que vaille au gré d’adaptations conjoncturelles ? Si une lecture chronologique du journal fait apparaître que les déclarations d’intention imprimées dans les traités d’agronomie semblent souvent rattrapées par les mesures d’urgence qui s’imposent lors des crises de subsistance présentant un risque vital (1775, 1782-1785 et 1789), ces dernières ne font en réalité que répéter, préciser et précipiter les grands principes de l’agriculture nouvelle.
Dans la masse d’articles parus de 1772 à 1789, on a retenu trois thèmes à propos desquels il est instructif de saisir comment le périodique se positionne. On verra que celui-ci, bien qu’il se prétende en quelque sorte le miroir des journaux de son temps, s’écarte volontiers de sa simple vocation de « digest du lecteur » pour devenir un inspirateur d’opinion, voire un maître à penser, soucieux d’assister son audience dans le taillis serré des dilemmes et des inquiétudes du temps. On constatera aussi que nous sommes loin d’une histoire événementielle cantonnée dans les circonstances du moment, mais au contraire dans la longue durée et, pour ainsi dire, dans l’histoire des besoins élémentaires de l’espèce.
1. LE COMMERCE DES GRAINS

En matière agricole, la première grande préoccupation répercutée par l’Esprit des journaux concerne sans conteste le commerce des grains. Le périodique n’avait pas encore atteint ce qu’on a coutume d’appeler sa « vitesse de croisière » que Turgot est nommé contrôleur général des finances, le 24 août 1774, et ministre d’État, deux jours plus tard. Le jeune intellectuel, collaborateur de l’Encyclopédie, ami des philosophes, arrive aux Finances auréolé des réformes fiscales, économiques et administratives entreprises entre 1761 et 1774 comme intendant du Limousin. On sait qu’une de ses premières initiatives consista à libérer le commerce des grains, par un arrêté du 13 septembre. La mesure va donner lieu à des échanges de vues d’une grande vivacité dont résonne le périodique. En s’en défendant et sans prendre trop ouvertement parti, celui-ci va adopter une position (en faveur de cette libéralisation) dans le débat.
Rien ne laissait présager la réception que le journal réserverait dès janvier 1775 à cette nouvelle législation. À peine un an plus tôt, en octobre et novembre 1773[9], il avait reproduit les extraits de deux éloges rendus à Colbert. L’ancien contrôleur général des Finances n’était-il pas honni de Turgot, au nom des principes physiocratiques ? Necker avait signé le premier de ces discours : on sait comment il s’opposera bientôt aux idées de Turgot sur la question des grains, quand il prendra la relève des Finances. L’autre éloge était dû à Joseph-François Coster, frère du fondateur et rédacteur de l’Esprit des journaux, Jean-Louis Coster[10]. Le morceau commençait par un paragraphe qui laissait peu de doutes sur les opinions du journaliste :
Il était temps que l’Académie française proposât l’Éloge du grand Colbert, pour le venger enfin de la foule de ses détracteurs. Jamais leur nombre n’avait été si considérable que dans ces dernières années, où de prétendus Économistes l’ont accusé avec aigreur d’avoir encouragé les manufactures en France aux dépens de l’agriculture[11].
Entre 1773 et 1775, la situation, tant du point de vue du contexte politique que sous l’angle rédactionnel, a changé. La France connaît un nouveau roi et un nouveau maître des Finances. Une nouvelle équipe s’est mise en place à la tête du périodique. Elle se compose maintenant, pour autant que l’on sache, de Louis-François de Lignac[12] et de l’abbé Outin[13], qui ont remplacé Coster. Plus qu’à l’opportunisme, c’est sans doute à ce changement qu’il faut attribuer le culte que la publication va vouer à Turgot à partir de 1775, sans qu’il s’éteigne après qu’il ait été démis de ses fonctions.
Pour évoquer l’esprit de libéralisation qui s’installe, le journal a rassemblé dans sa première livraison pour 1775 les éléments d’une controverse, sous l’intitulé « Querelle entre M. Linguet, auteur du Journal de politique et de littérature, et M. l’Abbé Roubaud, auteur du Journal et de la Gazette d’agriculture, etc.[14] ». Sont ainsi compilées, dans l’ordre chronologique, les lettres que Linguet, partisan d’une « économie morale », et Pierre Joseph André Roubaud, partisan d’une économie de marché, ont échangées via leurs périodiques respectifs entre le 25 octobre 1774[15] et décembre 1774. Ce duel épistolaire par voie de presse a pour objet l’Avis au peuple sur l’impôt forcé qui se percevait dans les halles et marchés sur tous les bleds et toutes les farines[16] de Nicolas Baudeau.
Les adversaires ne sont pas inconnus des lecteurs de l’Esprit des journaux. Celui-ci a mentionné Linguet à propos de sujets littéraires[17]. De Roubaud, il a reproduit une lettre[18] sur la très discutée question anthropologique des Patagons[19] et consacré un long article aux tomes X, XI et XII de son Histoire générale de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique[20]. Baudeau, l’auteur de l’objet de la polémique, est physiocrate. En novembre 1765, il a créé le premier journal économiste, les Éphémérides du citoyen qui, abandonné en novembre 1772, sera repris deux ans plus tard sous l’intitulé Nouvelles Éphémérides économiques. De surcroît, il serait également l’inventeur du mot « physiocratie[21] ». Son Avis au peuple est en fait une réédition. Il l’avait fait imprimer une première fois, sans le signer, en 1770[22], à l’époque où l’abbé Terray, le prédécesseur de Turgot, durcissait la réglementation sur le commerce des grains en établissant l’obligation de vendre et d’acheter exclusivement ceux-ci sur les marchés. L’essai a la forme d’une lettre de 16 pages datée du 14 novembre 1770, adressée par un fermier des droits de halle et de marché à un de ses confrères. On s’y félicite, arithmétique à l’appui, des bénéfices que cette contrainte va leur rapporter. Dans le texte introductif de l’impression de 1774, l’éditeur justifie la réédition en écrivant que l’auteur n’a pas pu en 1770 donner « à cette plaisanterie toute la publicité qu’elle aurait méritée ».
Épinglé par Linguet, le mot « plaisanterie » va mettre le feu aux poudres. Est-il bien adéquat, demande-t-il de « plaisanter sur les lois » ? « La plaisanterie », réplique Roubaud, « n’est que dans la tournure ou dans le caractère des personnages qu’elle introduit » et non dans le sujet, qui est évidemment « très grave ». Le ton de l’échange est donné, et les 64 pages de la dispute ne le démentiront pas. Elles roulent notamment sur la forme, chacun reproche à l’adversaire d’employer un vocabulaire inadéquat, de s’exprimer de façon obscure, d’être de mauvaise foi, de tendre des pièges grotesques, voire d’être l’agresseur par qui le combat a commencé. Peu à peu, on en vient au fond.
Linguet, partisan de l’interventionnisme, défend l’idée que seule une réglementation forte permet d’assurer la stabilité du prix de pain en le rendant indépendant des aléas climatiques :
Les premiers froids sont venus. Le pain est aujourd’hui à trois sols : il n’y restera pas, Monsieur, je vous le prédis avec douleur : il augmentera, et il faudra, tout en prêchant la liberté, chercher des moyens pour suppléer à l’insuffisance de ce fantôme qui vous a trop séduit.
Pour Roubaud, partisan du laissez-faire, seule la liberté du commerce est à même d’assurer l’intérêt du plus grand nombre :
L’intérêt de ce peuple est que les subsistances et les moyens de se salarier se multiplient ; et les subsistances et les moyens de salarier ne se multiplient que par l’extension et l’amélioration de la culture ; l’extension et l’amélioration de la culture dépendent du bon prix habituel des denrées ; et le bon prix habituel des denrées dépend de la liberté et de l’immunité du commerce.
Le débat ouvert par Linguet sera refermé par Roubaud qui, dans un ultime paragraphe, fera remarquer à son adversaire qu’on dit « entrer » et non pas « rentrer » en matière…
À ce stade, rien ne permet de définir une position de l’Esprit des journaux, qui a offert à deux adversaires de même gabarit[23] un espace d’expression identique. Mais le rapport change un mois plus tard. En février 1775, le périodique publie simultanément quatre textes qui militent tous en faveur de la liberté du commerce des grains.
Le premier a la forme d’un petit écrit signé d’un des pseudonymes les plus reconnaissables de Voltaire[24] : « F. de V***. S. de F. & T. Gent. Ord. D. R. », pour « François de Voltaire, seigneur de Ferney et Tourney, gentilhomme ordinaire du Roi ». Il est extrait de la Gazette universelle de littérature (nous reviendrons encore sur ce texte lorsque nous évoquerons l’engagement du périodique liégeois en faveur de la culture de la pomme de terre). Le deuxième texte présente une question posée par un paysan, le bien nommé Duchamp, suivie de la réponse[25]. Il avait paru d’abord dans la Gazette d’agriculture. Le troisième se donne comme la lettre adressée par un journalier et soldat provincial de la Généralité de Tours à l’abbé Baudeau[26], telle qu’elle avait été publiée dans les Nouvelles Éphémérides économiques. Le quatrième texte, une poésie fugitive porte comme paraphe D. G., une signature du pré-physiocrate Ange Goudar, lequel compare Turgot à Sully, considéré par les physiocrates comme le véritable père de leur mouvement[27].
La variété de ces témoignages, dus à des auteurs présentant des statuts différents, à partir de périodiques non moins divers, assure d’une certaine manière la légitimité du recueil fourni par l’Esprit des journaux à ses lecteurs, susceptibles d’appartenir à des milieux sociaux et à des tendances intellectuelles également contrastées. Ce procédé typique sera également adopté quand le journal accompagnera Parmentier dans sa croisade en faveur de la pomme de terre.
En avril 1775, Turgot entre dans la tourmente. Les mauvaises moissons de 1773 et 1774 ont provoqué une hausse brutale du prix du pain et le soulèvement populaire connu sous le nom de « Guerre des farines », que les adversaires du ministre attribuent à la libéralisation du commerce du blé. Ce même mois, le périodique liégeois reproduit, dans la partie « Mélanges », dix pages de Maximes générales du gouvernement agricole le plus avantageux au genre humain de François Quesnay, un des fondateurs de la physiocratie[28]. Une trentaine de pages plus loin est reproduite une poésie fugitive anonyme, composée par l’académicien Bernard-Joseph Saurin, intitulée « Épître à M. Turgot[29] ».
Necker publie au même moment, avec privilège, son ouvrage Sur la législation et le commerce des grains où il s’oppose à la réglementation de Turgot, en particulier sur l’exportation des grains. Le journal en propose le compte rendu en juin[30]. La proximité des dates de publication plaide fortement en faveur d’une rédaction due à un des journalistes de la feuille liégeoise. En voici l’introduction :
Cet ouvrage est tout à fait contraire aux principes du gouvernement actuel de France, qui par une suite de ces mêmes principes ne s’est pas opposé à ce qu’il fût rendu public[31]. (…) Si M. Necker ne persuade pas toujours, du moins fait-il douter, et n’adoptant pas son opinion, on a quelque crainte de se tromper ; ce qui est beaucoup dans une discussion de cette nature, et pour un objet qui tient aux plus grands principes de la Société, ramène aux droits les plus anciens de la nature humaine, intéresse l’ordre public, tout l’État en général, et chacun de ses membres en particulier ; le plus grand comme le plus petit ; le pauvre comme le riche.
On voit que les commentaires restent circonspects. Que disent-ils des modalités de la suppression des frontières régionales ?
La seconde partie qui traite de la liberté intérieure, offre des observations intéressantes, mais non des arguments assez forts pour faire rejeter cette liberté ; si elle a quelques inconvénients, elle a des avantages, et nous la croyons même de justice ; car tous les membres d’une société politique, ne pouvant être considérés que sous l’aspect d’une grande famille, doivent tous être également traités par le père commun, le Souverain. La loi qui commande à l’un, doit être la même que celle qui oblige l’autre.
Dans le même volume, un article sur la mise en vers du Pygmalion de Jean-Jacques Rousseau, par Berquin[32], duplique une idylle mettant en scène un couple de laboureurs menacés de quitter leur habitation.
Viens, ne crains point, nous serons tous heureux :
L’ami du laboureur est assis près du trône. (…)
Grâce te soit rendue, ô notre jeune Prince !
Pour le choix bienfaisant qu’a su former ton cœur.
Turgot faisait fleurir une vaste province ;
Tu veux que tout l’État lui doive son bonheur.
Tes vœux seront comblés, ô Louis, il nous aime ;
Qui connaît mieux que lui nos besoins et nos maux ?
L’Esprit des journaux affirme que le médaillon a pour base une anecdote « que conservera l’histoire » :
Dans une famine cruelle qui ravageait le Limousin, on a vu M. Turgot parcourir les campagnes de cette province, descendre dans les chaumières pour en consoler les malheureux habitants, et après avoir goûté lui-même leur pain mêlé de cendre, leur prodiguer les plus généreux secours.
Nouvel éloge de Turgot en septembre. Des « Vers pour le portrait de M. Turgot, Contrôleur-Général des Finances[33] » de Jean-François de La Harpe, célébrant ses bienfaits aux pauvres et aux opprimés, sont reproduits dans les « Poésies fugitives » :
Ses talents, son courage et sa raison profonde,
Sont dignes de sa place et du choix de Louis.
Le pauvre et l’opprimé sont ses premiers amis.
Et le vœu de son cœur serait de faire au monde
Le bien qu’il fait à son pays.
Celles-ci proposeront encore, en janvier 1776, une pièce de Feutry, « Imitation d’un Fragment d’Ennuis[34] », tout à la gloire des qualités du ministre, qui n’est que sagesse, probité, désintéressement.
Ce fragment, dont je n’ose à Turgot faire hommage,
Est un tableau fidèle où l’on voit son image
En février, le journal reprendra le poème de Saurin[35] paru dans le numéro d’avril de l’année précédente. L’auteur signe cette fois son épître mais son destinataire est maintenant dissimulé derrière une initiale : « Monsieur T. » Caprices de la fortune…
Turgot est en effet « démissionné » le 13 mai 1776. Pourtant, en juin et août, l’Esprit des journaux s’étendra longuement sur les Recherches sur la nature et les causes de la richesse des Nations d’Adam Smith, un des textes fondateurs du libéralisme économique, qui vient de paraître en anglais, et dont les idées auraient été influencées par Turgot[36]. En septembre, le journal rendra compte des deux premiers tomes de l’édition dressée par Baudeau des Économies royales de Sully[37]. Au cours des années qui suivront, le périodique ne ratera aucune occasion de rendre hommage à l’ancien contrôleur des Finances, quitte à la créer. Ainsi, en juillet 1779, il terminera sa recension des Mois de Roucher[38] par la reproduction d’un extrait de l’éloge du poète à Turgot :
Ministre, de qui Rome eût adoré l’image,
Au nom du laboureur je viens te rendre hommage.
Ton éloge, en ce jour, me doit être permis ;
Quand la faveur des rois te faisait des amis,
Je me suis tu : mon vers suspect de flatterie,
Eût été vainement l’écho de la patrie.
Mais lorsque tu n’as plus d’autre éclat que le tien,
Lorsque de ton pouvoir mon sort n’attend plus rien ;
Je puis, libre de crainte, ainsi que d’espérance,
Bénir mon bienfaiteur et l’ami de la France.
Et bien au-delà des limites historiques de notre étude, au mois de thermidor an 7 (19 juillet-17 août 1799)[39], l’Esprit des journaux agrémentera sa critique de la Notice sur la vie et les ouvrages de Condorcet, d’Antoine Diannyère, de ce jugement :
Le sage Turgot voulait ôter au commerce des grains ses entraves : M. Necker fit un gros livre pour empêcher ce progrès de la raison.
2. LE VIN
De toutes les productions de la terre, il n’en est point qui, après le bled, soit plus précieuse que la vigne, principalement en France, dont les vins pour l’usage ordinaire de la table ont une supériorité décidée sur ceux des autres pays. C’est donc travailler utilement pour la patrie que de chercher, comme l’a fait M. Maupin, à perfectionner cette seconde branche de l’agriculture[40].
Il faut dire que la « branche » en question est en plein essor. Sévèrement réglementée voire prohibée au cours de la première moitié du 18e siècle — les pouvoirs publics redoutant qu’elle n’occupe des terrains labourables ou pouvant servir de pâturages —, la culture de la vigne est libérée par un édit de 1759 qui supprime toute limitation ou interdiction. L'exploitation de cette culture à haut revenu ira en s’accroissant au cours des décennies suivantes. En 1789, 1,6 millions d’hectares seraient couverts par des vignobles, soit 25 % de plus qu’à la fin des années 1720, et la production de vin serait passée annuellement à 27 millions d’hectolitres, soit à 50 % de plus que dans ces mêmes années. Sur cet énorme réservoir à libations, 700 mille hectolitres seraient consommés par la population parisienne[41]… L’Esprit des journaux a donc toutes les raisons, en mai 1780, d’évoquer ici une « seconde branche de l’agriculture ».
Parmi les agronomes qui écrivent sur le sujet, l’Esprit des journaux a choisi Maupin pour incarner la boisson qui « fait (…) deux ou trois fois par jour du bien à un très grand nombre d’hommes[42] ». Entre 1772 et 1781, le périodique rendra compte de quatre de ses ouvrages : l’Art de bien faire le vin, à l’usage de tous les vignobles, en septembre 1772 ; l’Art de faire le vin rouge, contenant les premiers procédés publiés par l’auteur, et les nouveaux qu’il a imaginés depuis, en mai 1776 ; l’Art de la vigne en mai 1780 ; et enfin la Richesse des vignobles en 1781. Après cette date, Maupin continuera à écrire sur le sujet mais le journal ne donnera plus d’échos à ses publications, ni d’ailleurs à celles d’autres agronomes étudiant cette matière. Nous tenterons d’apporter une explication à cette désaffection.
Mais qui est ce spécialiste, qui inonde le marché de ses livres et brochures (plus de trente titres parurent sous son nom entre 1763 et 1791[43]) ? Peu d’informations circulent à son sujet. Son véritable nom est inconnu ainsi que ses dates de naissance et de mort mais il semble à peu près certain qu’il fut un des valets de chambre de la reine Marie Leszczynska, épouse de Louis XV[44]. Si on connaît peu de choses sur sa vie, l’Esprit des journaux en apprend beaucoup sur sa personnalité. Autant qu’à ses procédés, il s’est en effet intéressé à son caractère et à ses querelles. Chacune des recensions s’accompagne de déclarations où Maupin se plaint d’être incompris et menace de garder pour lui ses découvertes s’il n’obtient pas plus de reconnaissance ou de souscripteurs. L’image qui ressort est ainsi celle d’un « écrivain agronomique pittoresque[45] », pour reprendre l’image d’A. J. Bourde.
Son principal adversaire, et le plus visible, est l’abbé Rozier qui, par le biais de ses Observations sur la physique et de son Cours complet d’agriculture, critique ses expériences et lui reproche de s’octroyer la paternité de procédés antérieurs, bref de recycler des vieilles méthodes. Reproches que notre journal va s’empresser de relayer tout en déplorant qu’ils aient lieu et en se défendant d’entrer dans « des querelles qu’il faut bien appeler querelles littéraires, puisqu’elles s’élèvent dans le sein de la littérature[46] »…
Recycler de vieilles méthodes ne représente pas une accusation négligeable de la part de Rozier. Les deux hommes évoluent en effet sur un nouveau territoire : l’œnologie, entendu comme l’art d’améliorer la valeur des produits de la vigne. Un tel progrès ne peut intervenir qu’au prix d’un abandon des pratiques traditionnelles et d’une réforme des procédés de fabrication. Il est vrai que le mot œnologie n’était pas récent, à l’époque où nous nous trouvons. Il apparaît dès 1636 dans le titre d’un ouvrage de Lazare Meyssonnier, l’Œnologie ou discours du vin et de ses excellentes propriétés, mais sera popularisé par Edme Béguillet en 1770 dans Œnologie ou Discours sur la meilleure méthode de faire le vin et de cultiver la vigne. C’est à partir de cette publication que les agronomes spécialisés vont s’attacher à systématiser, théoriser et perfectionner, avec le secours de la science, ce qui apparaissait jusque-là comme un ensemble de pratiques locales.
Dans le discours préliminaire au Cours complet de chimie économique, pratique, sur la manipulation et la fermentation des vins paru en 1779, Maupin a résumé les enjeux de cette « science agricole nouvelle[47] » :
Où finit l’art de la vigne en commence un autre dont le but n’est pas de faire croître la denrée, de la cultiver et de la multiplier, mais de la façonner et de lui donner une plus grande valeur. Cet art est celui des vins… Art purement chimique et qui peut se regarder, en France, comme le plus important des arts de la chimie, non seulement par son influence sur la seconde partie de notre agriculture et la première branche de notre commerce, mais encore par son rapport avec la santé et la conservation des hommes. Si, faute de cet art, les vins sont faibles, de petites qualité, ou mauvais, ils seront mal vendus et nos pays de vignoble seront dans la détresse surtout dans les années abondantes. La culture des vignes n’en souffrira peut-être pas, mais ce sera les cultivateurs, c’est-à-dire ce que nous avons de plus cher dans la culture. Si nos vins ne se vendent pas ou se vendent mal, ce ne sera pas seulement notre agriculture qui en souffrira ; ce sera encore le commerce et le commerçant, car l’intérêt du commerçant est de vendre beaucoup et de vendre bien. Or, en général on vend peu et mal une mauvaise denrée. Si nos vins sont sans chaleur et, en outre, verts et mordants, comme il n’arrive que trop souvent, ils nuiront essentiellement à la santé et à la conservation d’une portion considérable de la nation. Ce sera un fléau public qui sera d’autant plus grand que les vins seront plus communs[48].
S’ils sont d’accord sur les objectifs, les agronomes ne le sont pas sur les procédés. La discorde entre Maupin et Rozier porte en particulier sur l’égrappage. En 1776, dans l’Art de faire le vin rouge, le premier préconise de laisser une partie des tiges fermenter avec les raisins : « (…) la rafle durcit le vin et lui donne plus de grossièreté, [mais] en même temps elle excite la fermentation et contribue en certains cas à améliorer les vins faibles (…) le vin doit être fait de raisins égrappés seulement aux trois quarts ou aux deux tiers. » Il défie ainsi l’abbé Rozier qui, quatre ans plus tôt, dans son Mémoire sur la meilleure manière de faire et de gouverner les vins de Provence recommandait un égrappage radical. Rozier contre-attaquera dans les Observations sur la physique[49] en accusant son adversaire de publier un ouvrage qui « n’est qu’une répétition de ce qu’il a fait imprimer et réimprimer plusieurs fois depuis 1772 » : « Dans cet ouvrage, comme dans les précédents », Maupin montre « qu’il ne sait pas la chimie ». Chez lui, « ni découvertes, ni procédés nouveaux » : « tout ce qui est imprimé a été déjà dit et redit par tous les auteurs qui l’ont devancé ». L’abbé Rozier contracte l’engagement envers le public qu’il prouvera ses trois assertions — une attitude jugée assez positive par l’Esprit des journaux, qui en profite pour préciser les termes en vue de la souscription au prochain ouvrage de Maupin[50].
En mai 1780, le journal expose la méthode infaillible et universelle de Maupin pour cultiver la vigne[51]. Le secret de la réussite réside ici dans un écartement idéal des ceps, soit « un juste milieu entre un trop grand écartement et un trop grand rapprochement ». En plus d’être favorable à la vigne, ce système, souligne la recension, requiert moins de main-d’œuvre et moins d’engrais. « Ce qui tourne à l’avantage de toute l’agriculture. En effet, cette grande quantité de fumier qui n’est plus nécessaire aux vignes, peut être employée à l’amendement des terres à bled. » La réussite de l’opération reposant sur la stricte observance des « principes de l’art », le périodique consacrera quinze pages à la description des étapes de la méthode de Maupin. L’article se terminera, comme le précédent, par l’annonce de la souscription à un nouveau livre de l’agronome. Celui-ci précise cependant qu’elle n’aura lieu que « sur le vœu exprès des corps municipaux, ou plutôt de toutes les provinces ». Le journaliste ne pourra qu’exhorter l’auteur « à la patience, vertu nécessaire à tous ses pareils ».
La relation privilégiée entre Maupin et le périodique prend fin en octobre 1781 avec la recension de la Richesse des vignobles[52]. Au-delà des redites, l’occasion sera offerte de se plaindre de l’absence de règles aussi précises à propos des vendanges. « Personne ne serait plus en état de nous instruire sur ce point essentiel, que M. Maupin ; mais malheureusement il déclare qu’il ne traitera cette matière que sur le vœu des provinces mêmes. » Le spécialiste s’en explique : « C’est une matière de chicane, ou du moins d’une longue discussion, que je n’entreprendrai sûrement pas, que je ne sois bien assuré que ce ne sera pas inutilement. »
Le débat sur la culture de la vigne ne se limite pas toujours à des échanges aussi techniques. En 1776, dans un mémoire sobrement intitulé De la vigne, dont l’Esprit des journaux rend compte en quelques pages dans son numéro de février 1778[53], l’avocat Claude Durival dénie au Nouveau Monde le pouvoir de faire fructifier la vigne. Comment s’étonner de la place que trouve celle-ci dans les polémiques contemporaines relatives à la vitalité naturelle du « jeune » continent ou à l’atonie de ses sauvages habitants ? Le périodique, en particulier, s’était fait l’écho des paradoxes de Corneille De Pauw sur la dégénération de l’Amérique, contenues dans ses Recherches philosophiques sur les Américains. On peut d’ailleurs trouver curieux que le journal reproduise la thèse de Durival sans l’assortir de commentaires.
Maupin ne partageait manifestement pas cette thèse. Il aurait au contraire cherché de l’aide auprès de Benjamin Franklin et de Thomas Jefferson pour y implanter des vignobles[54]. Envoyant ses Éclaircissements concernant plusieurs points de la théorie et de la manipulation des vins à Franklin, en 1783, il l’accompagna de cette dédicace : « (…) vous y verrez que j’ai trouvé une nouvelle méthode plus simple, plus économique et plus parfaite pour planter et cultiver la vigne[55] ». Franklin ne manifesta sans doute pas à Maupin la gratitude que celui-ci escomptait car le 20 janvier 1789, dans une lettre à Jefferson, l’agronome français, après s’être plaint que la France profite de ses découvertes « sans lui en marquer aucune espèce de reconnaissance », il affiche amèrement le regret que les plantations de vignes n’aient pas été faites en Amérique selon ses principes :
Ce qu’il y a de certain, Monsieur, et pour le bien même des États-Unis, je crois devoir le dire à Votre excellence, c’est que j’ai donné mes découvertes pour l’Amérique comme pour l’Europe, que je les ai annoncées à Monsieur Franklin comme très utiles pour son pays, et que si les plantations de la vigne y eussent été faites suivant mes principes, elles auraient beaucoup moins coûté, la vigne rapporterait davantage, et les raisins mûriraient plus tôt. Il est encore certain qu’en y faisant les vins comme je l’enseigne, ils seraient beaucoup meilleurs[56].
Maupin accordera cependant un bon point à Jefferson pour avoir souscrit à son prochain ouvrage[57].
Au début de cette section consacrée au vin, on a dit que l’Esprit des journaux avait cessé de rendre compte des questions vinicoles à partir de 1781. La raison de cet abandon se trouve sans doute dans la crise qui frappe le secteur au début des années quatre-vingt. Une surproduction de quatre années (1778, 1779, 1780, 1781) superposée à une sous-consommation intérieure (augmentation du prix du pain ; désaffection progressive à l’égard du vin provoquée par des années de haut prix) et extérieure (blocus anglais) se traduisit par un effondrement des prix avec, comme corollaire, un écroulement du revenu viticole[58]. Il ne s’agit donc plus d’encourager la culture de nouvelles vignes, ni d’augmenter la productivité des cépages existants. Le périodique ne consacre aucune ligne à ces questions lorsqu’il rend compte en décembre 1785 de la traduction en français des deux tomes du Dictionnaire des jardins de Philip Miller[59], alors que celui-ci traitait notamment des « moyens nouveaux de faire et conserver le vin suivant les procédés actuellement en usage parmi les vignerons les plus instruits de plusieurs pays de l’Europe ». La crise fera sentir ses effets jusqu’en 1787, année où le vin réapparaît dans le périodique dans son numéro de septembre, à propos d’un discours d’Antonio Fulgoni sur sa conservation[60]. En 1788 paraîtront encore deux recensions de livres italiens figurant sur le même rayon[61]. Dans les trois cas, il s’agit d’ouvrages non traduits en français.
S’il n’a guère été prolixe sur les vertus du vin, le journal vantera néanmoins, aux dates extrêmes de notre étude, les qualités fortifiantes de la boisson. Le premier texte recensé est constitué d’une lettre anonyme écrite, en 1773, à M. C., médecin[62], dans laquelle il est question de l’interdiction de boire du vin décrétée par Mahomet. Son auteur attribue à cette prohibition la vulnérabilité des habitants du Levant aux maladies « épidémiques et funestes » telles que petites véroles malignes, fièvres putrides et pestilentielles. « Je ne sais, Monsieur, ce qui arriverait si l’on interdisait le vin aux Français ? », reprend à son tour le journal en citant l’épistolier :
Je crois qu’ils perdraient bientôt cette gaieté qui les distingue de toutes les nations ; les vendanges inspirent joie, et nos vins sont très propres à l’entretenir. Il se peut bien aussi qu’il y eût alors plus de maladie. Depuis quelques années il règne en France des fièvres épidémiques très malignes, et qui ne sont pas loin d’être pestilentielles. Cela ne pourrait-il pas venir de ce qu’on boit moins de vin qu’autrefois ?
Le frelatage par les marchands et l’augmentation du prix de vente seraient aussi responsables de cette baisse de consommation, obligeant la population à recourir à l’eau. Si l’auteur ne met pas en cause l’adéquation de cette dernière comme boisson, il estime qu’elle n’est pas suffisante pour corriger « le mauvais air et la mauvaise nourri- ture ». Contrairement au vin, elle ne peut servir « d’aliment et de remède tout ensemble ». « Depuis que cette lettre est écrite, ces fièvres ont ravagé les campagnes et les villes, particulièrement l’été dernier, et l’on peut dire qu’elles font plus de ravages à proportion de la disette de vin, qu’à proportion de la disette d’eau. » De là à conseiller de nourrir de vins doux les nourrissons et les gros bestiaux… Pour les premiers, le remplacement du lait maternel par le produit de la vigne donnerait des hommes « très sains et très robustes ». Quant aux animaux, une ration de vin administrée plusieurs fois par jour diminuerait sans doute leur mortalité…
En août 1789, l’Esprit des journaux reproduit l’Avis sur la santé des moissonneurs rédigé le 10 juillet 1789[63] par l’abbé Tessier à la Ferme royale de Rambouillet, dont il est le directeur. Sorte de recette pour fortifier un journalier, cet avis plaide pour la consommation vinicole pour pallier la malnutrition des ouvriers saisonniers que la misère et la disette rendent inexploitables. Tessier conseille aux fermiers « de les faire venir chez eux quelques jours avant de commencer leur récolte, afin de les accoutumer par degrés à une meilleure nourriture, et de les fortifier d’avance ». Il leur recommande diverses boissons alcoolisées à cet effet — bière, cidre, hydromel —, le vin constituant la plus « fortifiante et la plus agréable » d’entre elles. En l’absence de ces breuvages, l’abbé conseille de suppléer avec un mélange de miel, d’eau-de-vie et d’eau, dans des proportions variables et selon les prix pratiqués dans les diverses régions.
Ces moyens réunis (…) mettront ceux qui viennent de loin en état d’emporter dans leur pays, avec la santé, de quoi payer ce qu’ils doivent, et de quoi nourrir leurs familles ; les fermiers eux-mêmes y gagneront, puisque leur récolte se faisant mieux et plus promptement, sera à l’abri de beaucoup d’accidents.
3. DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES BESTIAUX

L’Esprit de journaux affronte ici trois événements majeurs : l’épizootie de 1775, le retour des grands traités vétérinaires en 1782, la crise fourragère de 1785.
Plus que par sa gravité et son étendue, l’épizootie de 1775 est restée dans l’histoire par la modernité des mesures sanitaires prises par Turgot pour la juguler. La peste bovine qui décima les bêtes à cornes des provinces méridionales du sud-ouest de la France entre 1774 et 1776 s’était révélée d’autant plus préoccupante que cette région n’utilisait pas le cheval de culture, les bœufs apparaissaient donc comme l’unique source d’engrais et de traction des charrues. Ce qui amplifiait le risque, toujours latent, de disette[64]. Pour nous, qui avons en mémoire les règles sanitaires prises ces dernières années lors des épidémies de peste porcine, de grippe aviaire, de fièvre aphteuse et d’encéphalopathie spongiforme bovine, les réglementations imposées par Turgot ont une résonance familière : abattage massif des animaux, indemnisation des propriétaires, amendes aux agriculteurs qui cacheraient l’état de maladie de leurs bestiaux, interdiction de déplacer les bêtes, mise en quarantaine, perquisitions, cordons sanitaires, destruction des cadavres, primes d’encouragement[65]… Une dernière mesure[66], fixée après l’éradication de la maladie, établira une commission — on dirait aujourd’hui un institut de veille sanitaire —, qui, fusionnant en août 1778 avec la « Commission pour l’examen des remèdes secrets et des eaux minérales », deviendra la Société royale de médecine.
C’est en relayant une action philanthropique plutôt qu’en recensant les ouvrages écrits à l’occasion de l’épidémie (le plus célèbre étant l’Exposé des moyens curatifs et préservatifs qui peuvent être employés contre les maladies pestilentielles des bêtes à cornes de Félix Vicq d’Azir) que le périodique liégeois va informer ses lecteurs de cette crise agricole. En avril 1777, il pouvait ainsi rendre compte de la Lettre pastorale de Marc-Antoine de Noé, évêque de Lescar, capitale du Béarn, sur les ravages causés dans son diocèse par la mortalité des bestiaux[67]. Le message est typique des actions que réclame une politique sociale des Lumières. Il s’agit de convaincre le clergé et les riches habitants de la région de verser de l’argent aux deux caisses de secours qu’il a créées. L’humanité impose de secourir les « malheureux qui, en perdant leurs bestiaux, ont perdu toute espèce de ressources pour l’agriculture ». Avant de lancer cet appel à la bienfaisance, l’évêque aurait obtenu de Louis XVI un million de livres[68]. Noé peut faire valoir une voix qui porte / évêque de Lescar depuis 1763, il est aussi, à ce titre, président des états de Béarn et premier conseiller au parlement de Pau. Aussi sa lettre commence-t-elle par une verte menace à l’adresse des gens fortunés qui manqueraient de générosité. Il est à craindre qu’une terre nourricière du riche comme du pauvre, laissée à l’abandon par manque de labourage et d’engrais, « ne se couvre de ronces et ne se venge de vos refus par les siens ». Ne peut-on redouter que l’indigent « retombe à la charge du riche, ou par la mendicité, ou par les rapines » ? Par suite de la misère et de l’émigration, l’homme dans l’aisance trouvera-t-il encore des bras pour exploiter ses champs, ou des acheteurs à qui en vendre le produit ? Le ton se durcit quand l’évêque s’adresse aux membres du clergé :
Nous, Ministres du Seigneur, nourris des dons offerts sur ses autels, enrichis des largesses des peuples ; Nous qui, moissonnant où nous n’avons pas semé, et recueillant où nous s’avons pas labouré, jouissons de la rosée du Ciel et de la graisse de la terre. Refuser à Dieu, en la personne de ses enfants, une partie de ses bienfaits, la refuser aux descendants des pères qui nous ont enrichis aux dépens de leur postérité, à ceux mêmes qui partagent avec nous le fruit de leurs travaux, ce serait et pour vous, riches du siècle, et pour nous, Ministres des autels, je ne dis pas une injustice, mais un sacrilège ; je ne dis pas une ingratitude, mais un homicide digne du courroux du Ciel, et de l’animadversion des hommes.
Encore faut-il veiller à la bonne organisation des secours. À Pau, « deux caisses » se répartiront les « sommes que les divers corps ou les particuliers y verseront soit à titre de don, soit à titre de prêt ». Un trésorier, un secrétaire et des administrateurs se réuniront chaque semaine en bureau et rendront compte de leur gestion aux assemblées générales au moins deux fois par an. Pour obtenir réparation, les laboureurs sont, de leur côté, tenus de présenter un dossier décrivant l’état de leurs pertes et de leurs besoins. Lorsqu’un d’entre eux ne pourra rembourser la somme reçue à titre de prêt, l’évêque propose qu’elle soit prise dans les 15 000 livres qu’il a lui-même versées à la caisse. Plus haute la position sociale, plus grand le devoir. L’Esprit des journaux n’aura pas de termes assez élogieux pour qualifier la campagne de l’évêque qui, outre les bienfaits dont bénéficie le peuple, ne profite pas moins à la religion. « C’est, nous osons le dire, la meilleure réponse à tous les blasphèmes de l’impiété, aux cris de ces hommes insensibles qui s’élèvent contre le christianisme, et qui ont l’audace de présenter un tableau chargé des couleurs les plus infidèles, en relevant les maux prétendus qu’il a faits au genre humain. »
Notons qu’un courrier adressé par La Harpe[69] au grand-duc Paul de Russie se réfère à la lettre de Noé, en s’étonnant que celle-ci soit de sa main et non de celle d’un secrétaire, comme il était assez souvent d’usage. « C’est un morceau écrit avec éloquence, et les vérités qu’il contient acquièrent un nouveau prix dans la bouche d’un évêque. Il est le premier qui ait parlé avec tant de franchise et de désintéressement des richesses que le clergé doit à la piété des premiers âges. » Aussi la Lettre pastorale a-t-elle « eu beaucoup de succès ». L’engagement personnel d’un aussi grand personnage permet aussi à La Harpe le rappel d’une plaisante saillie : « Ainsi on ne lui répétera pas le mot de l’abbé Boileau, attribué mal à propos à Piron. Un évêque disait un jour à cet abbé, Monsieur, avez-vous lu mon dernier mandement ? – Non, monseigneur, et vous ? »
Les événements d’ordre historique qu’on vient de rapporter — et qui doivent être replacés dans une perspective économique plus large — expliquent la démultiplication d’une littérature agronomique. On détachera ici les trois grands traités vétérinaires de l’année 1782.
Les Observations sur plusieurs maladies de bestiaux d’Alexandre-Henri Tessier donnent à l’Esprit des journaux l’occasion d’une considération de méthode[70].
Tous ceux qui s’appliquent à la science vétérinaire (…) ne devraient écrire qu’après avoir vu et observé par eux-mêmes : ce n’est pas assez dire, ils ne devraient écrire que sur ce qu’ils ont eux-mêmes vu et approfondi. Dans un art qui est encore au berceau, et dont les principes ne sont point connus, un homme sage, un homme éclairé, un homme qui n’est point un charlatan, ne peut compter que sur ses observations ; il ne peut que multiplier ses expériences et vérifier celles des autres ; en un mot, il ne peut que voir : heureux quand il a de bons yeux.
Tessier fait incontestablement partie de ce type d’observateur. Envoyé dès 1778 en Sologne et en Beauce par la toute jeune Société royale de médecine, pour examiner les bêtes malades, il fait état des observations qu’il a rassemblées sur les maladies épidémiques ayant touché moutons et vaches des deux régions. Les moyens proposés pour conjurer l’infection sont de type préventif, les seuls qui soient « vraiment utiles dans les épizooties ». Frappant une région particulière de manière récurrente et ne franchissant pas certaines limites régionales, la « maladie de Sologne » se présente du reste davantage comme une affection enzootique qu’épizootique. Tessier en conclut que cette « maladie rouge » trouve ses causes dans les pâturages humides du pays, où prolifèrent des plantes dangereuses, ainsi que dans les eaux stagnantes et corrompues ; s’y ajoutent le manque de fourrage en hiver, le confinement des bêtes dans des étables mal construites et mal entretenues, et le fait que les animaux sont trop souvent confiés à des « jeunes filles, incapables d’attention ».
Parmi les moyens « les moins douteux » pour préserver les moutons de la maladie, Tessier propose de creuser des canaux et ruisseaux qui feraient s’écouler les eaux stagnantes : la préoccupation relative à la qualité de l’eau est loin de constituer un sujet propre à l’agronomie des Lumières[71]. L’Esprit des journaux ne manque pas d’applaudir à cette idée. Assainir les terrains tout en permettant une circulation des marchandises par voie d’eau : « Quel est l’honnête homme qui ne désirerait pas que le gouvernement s’occupât de ces objets, qu’il y employât le soldat ; et qu’en enrichissant la Sologne, il augmentât les revenus de l’État ? » Ainsi, les bergeries seront placées dans des lieux secs. Les litières seront régulièrement renouvelées, afin de préserver de l’humidité. Il s’agit que, dans de plus vastes abris, « les animaux y soient à l’aise »… Augmenter la nourriture des bestiaux est une autre mesure préconisée par l’agronome.
Pour suppléer au manque de fourrages, il serait à désirer que l’on établit dans la Sologne des cultures de pommes de terre, de carottes et de turneps, espèce de navets, que les bêtes à laine mangeraient facilement, même dans les champs, et dont on les nourrit pendant l’hiver dans toute l’Angleterre.
Aux solutions proposées par Tessier, le journal liégeois en ajoute une autre : le partage des communes.
Si chaque habitant de la campagne avait la portion de pâturage, (…) on conçoit qu’il pourrait, en cas de besoin, l’enclore d’une bonne haie ; qu’il pourrait y fabriquer des ombrages, des remises, un bercail ; qu’il pourrait en détruire les insectes et les plantes dangereuses, en combler les fondrières, en faire écouler les eaux puantes ; qu’il pourrait la garnir d’herbes odorantes et salutaires ; qu’il pourrait y pratiquer des réservoirs propres à purifier les eaux ; en un mot, qu’il pourrait la changer en un parc délicieux qui fournirait un air pur, des aliments sains, et un terrain sûr.
Le journaliste décline les avantages qu’entraînerait ce nouvel ordre des campagnes. Les bestiaux ne seraient plus exposés aux ravages des maladies contagieuses. Chaque propriétaire ayant le loisir d’observer ce qui convient le mieux à son cheptel, « l’art de nourrir, de multiplier, de guérir les troupeaux, serait bientôt parvenu à son point de perfection ». On pourrait mieux déterminer le nombre et l’espèce de bétail pouvant être nourri par l’enclos.
On comprend assez que tous ces objets de réforme et d’utilité publique sont incompatibles avec l’état actuel des communes. Tant que les troupeaux seront condamnés à errer dans des pâturages communs, il sera aussi difficile de découvrir les vraies causes de leurs maladies, qu’il sera difficile d’y apporter du remède.
Un autre écrit se préoccupe du « bien-être » des animaux de la ferme : Le Traité du charbon ou antrax dans les animaux du directeur et inspecteur-général des écoles royales vétérinaires de France, Philibert Chabert[72]. L’anthrax se présente sous la forme d’une tumeur qui affecte les chevaux, ânes, mulets, chien, bœufs, moutons, chèvres et cochons. Selon les espèces, elle revêt un caractère plus ou moins inflammatoire. Ici également, le degré d’humidité se trouvera incriminé, ainsi que la mauvaise qualité de l’eau. La maladie étant contagieuse, Chabert préconise une série de règles — touchant notamment au commerce du cuir — pour en éviter la propagation.
Daubenton veut quant à lui mettre très directement et pratiquement ses connaissances à la portée du peuple des campagnes, dans ses Instructions pour les bergers et pour les propriétaires de troupeaux de 1782. L’ouvrage — fruit de quatorze années d’observations faites sur les bêtes à laine par ordre du gouvernement — est impatiemment attendu : l’Esprit des journaux a annoncé sa parution prochaine dans plusieurs articles. L’homme appartient à de nombreuses académies et a collaboré à l’Histoire naturelle de Buffon. Le journaliste[73] va ainsi souligner le didactisme de l’essai, fait de questions-réponses rédigées dans une écriture simple, claire et précise qui permet de l’utiliser pour apprendre à lire tout en apprenant un métier : « (…) les maîtres d’écoles des villages pourront s’en servir pour les jeunes gens qu’ils voudront exercer à la lecture, et instruire en même temps sur la manière de soigner les troupeaux. » Former des bergers est essentiel pour Daubenton, opposé à l’habitude de confier les animaux aux enfants peu à même de percevoir leurs besoins. L’Esprit des journaux avait plaidé pour le partage des communes, Daubenton préconise d’intéresser les bergers aux bénéfices, excellent moyen de les motiver à améliorer les troupeaux confiés à leurs soins. Il prend également position dans un des grands débats qui divise les agronomes : faut-il ou non élever les bêtes à laine en plein air et sans couvert ? Daubenton est partisan de cette option qui, dit-il, a fait ses preuves en Angleterre.
Dans quelle mesure de telles recommandations s’adressent-elles à un lectorat spécifique ? Qui est visé par des traités comme ce Parfait bouvier, lequel atteint en 1808 sa onzième édition[74] ? Comment se répandent les préceptes agronomiques répertoriés par Pons-Alletz — grand vulgarisateur des Lumières — dans son Agronome ou dictionnaire portatif du cultivateur, que Jean-François Bassompierre publie à Liège en 1770[75] ? Comme le note Chastellux dans son célèbre ouvrage sur la Félicité publique de 1772 :
Il y a certainement beaucoup de malheureux dans les campagnes, mais ce ne sont pas en général les laboureurs. En effet, ceux-ci sont séparés en deux classes, les fermiers, les métayers avec leurs domestiques, et les petits propriétaires, qui cultivent eux-mêmes leurs champs : or, ce ne sont pas ces deux classes qui sont les plus à plaindre. Ce sont les paysans sans propriété, qui ne possédant qu’une chaumière et leurs bras, dépendent, pour leur subsistance, d’un salaire incertain et toujours trop modique. C’est de ces infortunés dont les cœurs bienfaisants doivent être principalement occupés[76].
On ne rappellera pas ici la chronologie de la crise fourragère que connaît la France au printemps de 1785, annonciatrice de la tourmente révolutionnaire. Face à la sécheresse, Calonne, Contrôleur général des Finances depuis fin 1783, décrète diverses mesures : ouverture des bois appartenant au roi ou aux communautés religieuses aux bêtes à cornes et chevaux, distribution gratuite de graines de turneps, etc. Une Instruction sur les moyens de suppléer à la disette des fourrages, et d’augmenter la subsistance des bestiaux paraît en mai. Émanant de la Société royale d’agriculture, elle est tantôt attribuée à Lavoisier, tantôt à Parmentier. Celui-ci va donner bientôt une Instruction sur la culture et l’usage du maïs en fourrage. L’agronome Broussonnet privilégie quant à lui un autre légume, dans son Instruction sur la culture des turneps ou gros navets. Même la manière de cueillir les feuilles des arbres, de les conserver et de les donner à manger aux bestiaux fait l’objet d’une instruction, par Servières.
De ces publications, rédigées et distribuées dans l’urgence, retenons les points suivants, tels que les met en évidence l’Esprit des journaux dans ses numéros d’août et de septembre 1785[77]. La première Instruction pose le cadre général du débat. Il s’agit de considérer les « différentes méthodes qui pourraient être employées utilement selon les cantons, pour suppléer au défaut de nourriture ordinaire, et assurer partout la subsistance des bestiaux ». Le principe directeur est évidemment de favoriser les cultures moins dépendantes des aléas climatiques. Divers moyens sont à développer :
(…) la liberté de faire paître les bestiaux dans les bois, de cueillir l’herbe qui y croît, d’enlever la glandée ; l’emploi de l’émondage des arbres ; l’extraction des racines nutritives ; la préparation de quelques végétaux ; la récolte de plusieurs autres qu’on néglige ordinairement ; l’extension de cultures propres à fournir une nourriture abondante, entre autres celles de la pomme de terre et des navets, particulièrement de ceux connus sous le nom de turneps ; les prairies artificielles ; le fauchage anticipé des prés ; la conversion des jachères en prairies momentanées ; le chaulage du grain ; le parcage des moutons et autres bestiaux.
Ces propositions reçoivent dans le journal un traitement inégal, peut-être dû à la préoccupation de ménager la reproduction fourragère. Ainsi, il est traité plus longuement des conditions de pâturage dans les bois, qui peuvent compromettre celle-ci. Serait-ce pour la même raison que le périodique fera l’impasse sur l’Instruction sur la manière de cueillir les feuilles des arbres ? On ne trouve pas de trace de sa recension jusqu’à ce que l’ouvrage soit mentionné dans un article d’août 1786 sur les Mémoires d’agriculture, d’économie rurale et domestiques de la Société royale d’agriculture de Paris[78].
C’est au Journal de Paris que l’Esprit des journaux empruntera sa recension du mémoire de Parmentier en faveur du maïs. Pour évoquer les expériences agricoles menées par ordre du gouvernement, le périodique liégeois s’inspirera, pour la plupart de ses comptes rendus, du même journal, dès la parution de son premier numéro, en janvier 1777.
Le mémoire de Pierre-Marie-Auguste Broussonnet, de 1782, sur les turneps mérite davantage notre attention. À 24 ans, âge auquel il rédige cette instruction destinée à accompagner la distribution gratuite des graines de navets, son auteur cumule les distinctions : secrétaire de la Société royale d’agriculture, traducteur de J. R. Forster, membre de la Société royale de Londres et de l’Académie des sciences, suppléant de Daubenton au collège de France et son adjoint à l’école vétérinaire… On apprend dans la recension de l’Esprit des journaux que la culture de la plante a été développée dans la généralité de Paris par Bertier de Sauvigny, son intendant, et que le nombre d’arpents semés en 1785 a été décuplé par rapport à l’année précédente (on passe de 600 à 6 000).
Si la promotion du turneps est à l’ordre du jour dans les traités d’agronomie depuis plusieurs décennies, il n’en est pas de même de sa propagation dans les campagnes où la plante est généralement confondue à tort avec la rabioule. « Je ne sais », rapporte Rozier, « d’où vient la manie d’introduire des mots nouveaux et de franciser des noms anglais pour distinguer des plantes qui sont connues de toute ancienneté en France » ; le turneps n’est-il pas en somme « le gros navet que l’on cultive de temps immémorial en Dauphiné, dans le Lyonnais, le Beaujolais, la Savoie[79] » ? Arthur Young s’irritera de la confusion qui conduit les Français à sous-estimer la supériorité du véritable turnip made in Norfolk. Ne mesure-t-il pas le degré de développement d’un pays à l’aune de sa superficie cultivée en turneps ? À cet égard, il considère que la France se situe plutôt au 10e siècle qu’au 18e. L’Esprit des journaux conclut plus sobrement : « On pourrait dire que le turneps est pour le bétail ce que le blé est pour l’homme, un des plus riches présents de l’agriculture. »
•
Pour compléter notre analyse de trois thématiques agricoles mises en évidence par l’Esprit des journaux (grains, vin, maladies/fourrage du bétail), il est indispensable de se pencher sur la principale conquête agro-alimentaire des Lumières : la pomme de terre. Celle-ci fait son entrée dans l’Esprit des journaux en février 1775, à la faveur du petit écrit de Voltaire sur l’arrêt de Turgot relatif au commerce des grains[80]. Le philosophe y célébrait les « ressources infinies » qu’offrent au peuple, dans « l’année la plus stérile en blé », ces « pommes de terre qu’on cultive aujourd’hui partout avec un très grand soin » et dont on fait « le pain le plus savoureux avec moitié de farine ». Une phrase a suffi pour résumer les arguments de Parmentier[81]. Le Genevois exagérait sans doute quelque peu en prétendant que le légume est cultivé partout. Dans les années 1770, seules quelques régions françaises en pratiquent systématiquement la culture : Flandre, Picardie, Franche-Comté, Alsace, Bourgogne. Les cultivateurs des autres provinces sont réticents — résistance que les rédacteurs de l’Esprit des journaux vont s’employer à vaincre en se faisant l’écho du plaidoyer de Parmentier.
On trouve trace du pain de pommes de terre confectionné par Voltaire dans une lettre qu’il écrivit à Parmentier en avril 1775[82] après que celui-ci lui ait adressé deux écrits. Le premier, un Mémoire sur les végétaux nourrissants, a remporté le 24 août 1772 le prix du concours organisé par l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon sur le thème : « Indiquer les végétaux qui pourraient suppléer en temps de disette à ceux que l’on emploie communément à la nourriture des hommes et quelle devrait en être la préparation. » Le second mémoire, intitulé Examen chimique de la pomme de terre, apportait de nouveaux arguments en faveur du rapport rendu par la Faculté de médecine de Paris à l’abbé Terray, attestant la salubrité de l’aliment.
Le pain de Voltaire se constituait pour moitié de farine. Parmentier estime qu’on pourrait se passer de celle-ci, de sorte que le tubercule « ennobli par la panification[83] » devienne l’ingrédient incontournable de l’alimentation française. L’expérience du « pain-tout-pommes de terre » est réalisée le 20 octobre 1778 à la boulangerie de l’Hôpital royal des Invalides, en présence du baron d’Espagnac, du commissaire de police Jean-Charles-Pierre Lenoir et de Benjamin Franklin…
L’Esprit des journaux de février 1779[84] en relate fièrement la fabrication dans un article emprunté au Journal de Paris. La formule permettrait de remplacer le pain des pauvres en période de disette, car sa matière première ne craint ni les insectes, ni les gelées, ni la grêle et « croît presque partout ». En outre, ce pain pourrait être confectionné par le cultivateur lui-même, « qui peut à six heures du matin déterrer la pomme de terre de son champ et avoir d’excellent pain à midi », sans aide extérieure. La perspective était pour le moins illusoire. Le journaliste s’en rendra compte quand il tentera d’expliquer le procédé, quatre mois plus tard[85], à l’occasion de la recension de la Manière de faire le pain de pommes de terre, sans mélange de farine, petit ouvrage de 55 pages dû à Parmentier. Il faut en effet, pour mener à bien l’entreprise, disposer de plusieurs machines extrêmement complexes qui ne peuvent se trouver que dans un atelier de boulangerie.
L’Esprit des journaux reproduit dans le même numéro la lettre d’un cultivateur[86] qui témoigne du caractère révolutionnaire du pain de pommes de terre. Sa découverte « pourra devenir une des plus utiles pour tous ; mais surtout pour nous autres pauvres habitants des campagnes ». Mais voici qu’en juillet 1780, le périodique reproduit sans l’assortir d’aucun commentaire une Réfutation du pain de pommes de terre, sans mélange de farine[87], qui lui est tout spécialement adressée.
L’invention de Parmentier y apparaît non seulement impossible mais inutile : « La pomme de terre n’a besoin que d’être cuite dans l’eau ou sous la cendre pour servir de nourriture, et ne demande aucune préparation ; le pain [de pommes de terre] au contraire est très long à fabriquer et très coûteux : prix qui sera toujours très grand, si l’on calcule la perte de temps que l’on sera obligé d’employer pour y réussir. »
Le pain de pommes de terre ne sera plus désormais évoqué que de façon marginale. Ceci n’empêche pas le journal de faire écho à un nouvel écrit de Parmentier : ses Recherches sur les végétaux nourrissants, qui, dans les temps de disette, peuvent remplacer les aliments ordinaires, avec de nouvelles observations sur la culture des pommes de terre, de 1781[88]. On y propose une analyse chimique des aliments en général, considérés dans leur rapport avec la digestion, pour convaincre les lecteurs qu’après le froment, la pomme de terre reste bien un aliment idéal, où le principe nourrissant est présent dans la meilleure proportion. L’occasion est fournie de revenir sur la question du pain totalement réalisé avec le tubercule. « Il ne faut pas regarder (…) le bénéfice de changer la pomme de terre en pain comme satisfaisant seulement l’imagination du peuple. » L’Esprit des journaux acquiesce : là « où il ne vient que des pommes de terre », le pain qui en procède offre « aux habitants de la campagne » l’unique moyen de se « sustenter toute l’année », sans que l’auteur exclue les « autres formes sous lesquelles on les mange ordinairement ».
L’histoire des moyens de subsistance nous apprend quel événement modifia la donne en faveur du tubercule. La disette des fourrages de 1785 conduit l’intendant de Paris, ainsi que le rapporte l’Esprit des journaux d’octobre 1786[89], à autoriser la « Société royale d’agriculture à disposer d’une partie de la plaine des Sablons pour voir jusqu’à quel degré le terrain le plus aride et le plus ingrat pourrait être propre à la culture de la pomme de terre ». On y mettra en concurrence quatre arpents de celle-ci, contre quatre arpents de turneps. Les résultats s’avéreront égaux et fourniront une autre occasion à l’esprit de bienfaisance. Bertier de Sauvigny, poursuit le journal en 1787, a offert la double récolte à la Société philanthropique de Paris qui l’a distribuée à ses vieillards, ainsi qu’à ses veufs et veuves[90]. Le périodique apprendra encore à ses lecteurs, en reproduisant un extrait d’un article du Journal de Paris du 3 août 1787, que l’expérience est renouvelée[91]. Il se félicite des succès obtenus sur une plaine « dont le nom seul caractérise la stérilité ». Le bienfait n’est-il pas redevable, par ailleurs, à ce Nouveau Monde, d’où provient un aliment qui, là-bas, « constitue la principale nourriture » ?
On sait que la période précédant la Révolution connut des conditions climatiques extrêmes. L’orage de grêle qui frappe la France le 13 juillet 1788 impose une réflexion sur la gouvernance agricole. Un Avis aux cultivateurs dont les récoltes ont été ravagées par la grêle du 13 juillet 1788 récuse, sous la plume de Parmentier, le « préjugé » selon lequel la grêle porterait « avec elle un poison mortel ». Sans doute agit-elle « mécaniquement en brisant, en hachant les végétaux, ce qui les fait nécessairement ou souffrir ou périr ». Mais les pommes de terre figurent parmi les végétaux qui peuvent être sauvés, si on les réchauffe, écrit l’Esprit des journaux[92], « soit par un léger binage, soit en les buttant ». Elles peuvent « braver la grêle que les autres végétaux ont tant à redouter ».
Nouveau plaidoyer de Parmentier dans un écrit dont le journal liégeois rend compte en juin 1789[93] : le Traité sur la culture et les usages des pommes de terre, de la patate et du topinambour. « La grêle et le froid, joints à la médiocre récolte de l’année dernière, ayant dû forcer d’ouvrir les yeux sur les avantages incontestables de la culture des pommes de terre, M. Parmentier a présumé que la leçon du malheur et du besoin vaudrait mieux, dans ces circonstances, que le succès de l’expérience la plus concluante. » Va en témoigner l’exemple irlandais.
L’Irlande offre au 18e siècle le tableau d’une région particulièrement frappée par la misère. Richard Twiss dresse celui-ci dans son Tour in Ireland in 1773, paru en 1776, qui ne sera traduit en français qu’en 1798 (par le Liégeois, et rédacteur de l’Esprit des journaux de 1794 à 1805, Charles Millon), mais dont des extraits sont publiés en traduction dans l’Esprit des journaux dès octobre 1776. C’est du reste une particularité du journal liégeois que d’avoir proposé dans la « langue de l’Europe » des extraits d’ouvrages qui n’atteindront le lectorat français que plus tard[94].
Les dehors de Dublin [écrit Twiss] sont remplis de huttes, qu’on appelle Cabbins ; elles sont construites de terre sèche, et le plus souvent sans fenêtre ni cheminée ; c’est dans ces tristes demeures que la plus grande partie des Irlandais traînent leur misérable existence. À côté de chaque Cabbin, il y a ordinairement un petit champ qui produit quelque peu de pommes de terres, c’est avec cela, et du lait, que les Paysans Irlandais se nourrissent pendant toute l’année, sans manger de pain ni de viande, excepté peut-être une ou deux fois, comme à Noël et à quelque autre fête semblable[95]…
L’Esprit des journaux, à la faveur du Traité de Parmentier de juin 1789, renchérira sur le propos en rappelant que la pomme de terre a sauvé les Irlandais de la pauvreté mais aussi de la maladie, car « rien n’est moins rare désormais de voir parmi eux des vieillards et des jumeaux autour de la cabane des paysans ». Le périodique égrène ensuite les noms de variétés que l’agronome « a cultivées et propagées dans le royaume » : la Grosse-blanche, la Blanche-longue, la Jaunâtre-ronde-aplatie, la Rouge-oblongue, la Rouge-dite-souris, ou Corne-de-vache, la Pelure-d’oignon ou Langue-de-Bœuf, la Petite-jaunâtre-aplatie ou Espagnole, la Rouge-longue-marbrée, la Rouge-ronde, la Violette, la Petite-blanche… Dans une sorte de ballet chorégraphié s’animent maintenant sous sa plume vieillards, femmes et enfants au milieu des vaches et des moutons. Que la vie se fait simple et belle « quand on réunit l’inspiration de l’intérêt personnel aux conseils d’un homme éclairé ».
On imagine Marie-Antoinette vaquant dans la bergerie du Petit Trianon, la truelle à la main, récoltant les « parmentières ». L’Esprit des journaux ne rappellera pas comment le roi et la reine avaient arboré quelques années plus tôt, lors de l’expérimentation des Sablons, le bouquet de fleurs de pommes de terre glissé à la boutonnière ou accroché à la perruque. Quand les cultures avaient commencé à porter, le pouvoir s’était gardé de les entourer d’une garde trop vigilante, car les chapardeurs du nouvel aliment en faisaient aussi la propagande et l’essai. Il n’entrevoyait pas ce que pouvait produire une « émeute » faute de pain, et moins encore une « révolution » par manque de « brioche ».
[*] Cet article a paru dans L'Esprit des journaux : un périodique au XVIIIe siècle, Actes du colloque « Diffusion et transferts de la modernité dans l’Esprit des journaux » organisé par le Groupe d’étude du xviiie siècle de l’Université de Liège (16-17 février 2009), éd. Daniel Droixhe, Bruxelles, Le Cri/ARLLFB, 2009.
NOTES

[1] J. Dupâquier, « Démographie », Dictionnaire européen des Lumières, dir. M. Delon, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1997, p. 368-373 ; Idem, « Un grand tournant dans l’histoire de la population française (1750-1850) », La Révolution, la France et l’Allemagne. Deux modèles opposés de changement social, dir. H. Berding, E. François, H.-P. Ullmann, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 1989, p. 14.
[2] V.-D. Musset-Pathay, Bibliographie agronomique ou Dictionnaire raisonné des ouvrages sur l’économie rurale et domestique et sur l’art vétérinaire, Paris, Imprimerie D. Colas, 1810. Chiffres cités par G. Béaur, Histoire agraire de la France au XVIIIe siècle, Paris, SEDES, coll. « Regards sur l’histoire », 2000, p. 168.
[3] Chronologiquement : Journal historique du commerce et des arts et manufactures (1745), Journal économique ou Mémoires (1751-1772), Gazette universelle de Commerce (1757-1758), Journal de Commerce 1 (1759-1762), Recueil de mémoires concernant l’économie rurale (1760-1761), Recueil contenant les délibérations de la Société d’agriculture de la généralité de Paris (1761), Mémoires et observations recueillies par la Société économique de Berne (1762-1773), Délibérations de la Société d’agriculture de Rouen (1763-1767), Gazette du commerce (1763-1783), Éphémérides du citoyen (1765-1772), Journal de l’agriculture (1765-1774, 1778-1783), Journal de Commerce 2 (1769), Journal historique et physique (1769), Nouvelles Éphémérides économiques (1774-1788), Choix économique et moral (1777), Journal économique et politique de Genève (1777), La Gazette du commerce et littéraire (1778-1779), Bibliographie physico-économique (1782-1826), Journal d’agriculture de l’Ain (1783-1848), Mémoires d’agriculture (1785-1791), Supplément au Journal général de France (1787-1790) (Dictionnaire des journaux (1600-1789), dir. J. Sgard, Paris, Universitas, t. II, 1991, p. 1 134). Treize d’entre eux seront, au moins en partie, contemporains de l’EdJ.
[4] La première société d’agriculture établie en France fut celle de la province de Bretagne, le 20 mars 1757.
[5] EdJ, février 1775, p. 272.
[6] Voir par ex. EdJ, avril 1775, p. 250.
[7] EdJ, mai 1775, p. 267.
[8] EdJ, mai 1785, p. 323.
[9] Respectivement, EdJ, 15 octobre 1773, tome IV, partie I, p. 38-42, et EdJ, 15 novembre 1773, tome V, partie I, p. 3-14.
[10] L. Trénard, « Coster, Jean Louis », Dictionnaire des journalistes (1600-1789), dir. J. Sgard, Oxford, Voltaire Foundation, t. I, 1999, p. 259.
[11] EdJ, 15 novembre 1773, tome V, partie I, p. 3.
[12] P. Vanden Broeck, « Lignac, Louis François Luc de », Dictionnaire des journalistes (1600-1789), op. cit., t. II, p. 651.
[13] L’abbé Outin ne possède d’entrée ni dans le Dictionnaire des journalistes de J. Sgard, ni dans les suppléments électroniques à ce dictionnaire.
[14] EdJ, janvier 1775, p. 220-284.
[15] Date du premier numéro du Journal de politique et de littérature fondé par Linguet.
[16] [S.l.] : [s.n.], 1774.
[17] « Lettre à l’auteur de l’Année littéraire sur l’inscription mise au bas de la statue de Louis XV », EdJ, 15 mai 1773, t. V, partie I, p. 41-47 ; « Extraits d’observations sur les deux Éloges de La Fontaine », EdJ, janvier 1775, p. 107-112.
[18] « Fragment d’une lettre à M. de G. de la Société électorale de… sur les grands Patagons », EdJ, 28 février 1773, t. II, partie II, p. 152-158.
[19] Voir D. Droixhe, « De la Critical review à l’Esprit des journaux. L’apport de l’information anthropologique anglaise de 1772 à 1789 », à par. dans France, Grande Bretagne, Irlande : Transferts culturels et parcours des savoirs au siècle des Lumières. Actes du colloque international, Université Paris Diderot, 18-20 septembre 2008.
[20] EdJ, 15 mars 1773, t. III, partie I, p. 34-40.
[21] G. Dulac, « Éphémérides du citoyen », Dictionnaire des journaux (1600-1789), op. cit., t. I, p. 353-355.
[22] Son titre était alors Avis au peuple sur l’impôt forcé qui se perçoit dans les halles et marchés sur tous les bleds et toutes les farines. C’est nous qui soulignons.
[23] Linguet est avec Necker, Galiani et Mably un des porte-drapeaux des interventionnistes, comme Roubaud est avec Turgot, Baudeau et Mirabeau un des fers de lance de la liberté absolue du marché.
[24] EdJ, février 1775, p. 189-195.
[25] Ibid, p. 196-203.
[26] Ibid, p. 204-211.
[27] Ibid, p. 231.
[28] EdJ, avril 1775, p. 178-189.
[29] Ibid, p. 219-221.
[30] EdJ, juin 1775, p. 92-104.
[31] Que Turgot n’interdise pas la publication de textes qui le contredisent a été souligné par Voltaire dans son Petit écrit… : « Le ministre certain de la bonté de ses vues, permet qu’on écrive sur son administration, et on se sert de cette permission pour le blâmer » (EdJ, février 1775, p. 191). Le 23 avril 1775, Necker fit parvenir un exemplaire de son ouvrage (Paris, Pissot, 1775) à Turgot qui lui répondit par cette lettre : « J’ai reçu, Monsieur, l’exemplaire de votre ouvrage que vous avez fait mettre à ma porte ; je vous remercie de cette attention. Si j’avais eu à écrire sur cette matière et que j’eusse cru devoir défendre l’opinion que vous embrassez, j’aurais attendu un moment plus paisible où la question n’eût intéressé que les personnes en état de juger sans passion. Mais, sur ce point comme sur d’autres, chacun a sa façon de penser. » Necker se justifia en disant qu’il avait reçu l’autorisation d’imprimer avant l’élévation des prix du grain et donc a fortiori avant les troubles.
[32] EdJ, juin 1775, p. 135-141.
[33] EdJ, septembre 1775, p. 251.
[34] EdJ, janvier 1776, p. 269-270.
[35] EdJ, février 1776, p. 269-271.
[36] EdJ, juin 1776, p. 82-104 et août 1776, p. 66-85.
[37] EdJ, septembre 1776, p. 38-47.
[38] EdJ, juillet 1779, p. 256-260.
[39] EdJ, thermidor an 7, t. XI, p. 28.
[40] EdJ, mai 1780, p. 33, à propos de l’Art de la vigne ; contenant une nouvelle méthode économique de cultiver la vigne ; avec les expériences qui en ont été faites, et l’approbation de l’Académie royale des sciences de Paris.
[41] G. Béaur, op. cit., p. 201 ; J. Bart, É. Wahl, « De grappe en verre : état des questions », Dix-huitième siècle, n° 29, 1997, p. 10.
[42] Maupin, L’art de faire le vin, nouv. éd., Paris, Musier fils, 1772, p. 4.
[43] Sur base du catalogue de la BnF, de la Bibliographie agronomique de Musset-Pathay (op. cit.) et de la France littéraire de Quérard (Paris, F. Didot, 1833, p. 642-644).
[44] H.W. Paul, Science, Vine and Wine in Modern France, Cambridge, University Press, 1992, p. 230.
[45] A. J. Bourde, Agronomie et agronomes en France au XVIIIe siècle, Paris, S.E.V.P.E.N., « Les hommes et la terre » XIII, 1967, t. II, p. 674.
[46] EdJ, mai 1776, p. 114-129.
[47] A. J. Bourde, op. cit., p. 664.
[48] Cours complet de chimie économique, pratique, sur la manipulation et la fermentation des vins, Paris, 1779, p. 3-4 (extrait reproduit par A. J. Bourde, op. cit., p. 686).
[49] Observations sur la physique, t. 6, juillet 1775, p. 265-266, à propos de l’Art de faire le vin rouge, de Maupin.
[50] EdJ, mai 1776, art. cit., p. 128-129.
[51] EdJ, mai 1780, p. 33-51.
[52] EdJ, octobre 1781, p. 164-169.
[53] EdJ, février 1778, p. 93-100.
[54] J.R., Hailman, Thomas Jefferson on Wine, University Press of Mississippi, 2006, p. 426, n. 27.
[55] E. Wolf, K.J. Hayes, The Library of Benjamin Franklin, Philadelphia, American Philosophical Society, 2006, p. 547.
[56] J.P. Boyd, The Papers of Thomas Jefferson, Princeton University Press, vol. 14, 1950, p. 477.
[57] Le Manuel des vignerons de tous les pays, apparemment.
[58] C.-E. Labrousse, La crise de l’économie française à la fin de l’ancien régime et au début de la Révolution, Paris, PUF, 1944.
[59] EdJ, décembre 1785, p. 200-210.
[60] EdJ, septembre 1787, p. 115-123.
[61] EdJ, avril 1788, p. 110-114, et juin 1788, p. 141-149.
[62] EdJ, novembre 1773, p. 140-149.
[63] EdJ, août 1789, p. 377-379.
[64] Sur les épizooties du xviiie siècle, voir Fr. Vallat, « Les épizooties en France de 1700 à 1850 », Histoire et sociétés rurales, Vol. 15 2001/1, p. 67-104.
[65] « Arrêt du 18 décembre 1774, qui prescrit des mesures pour arrêter cette maladie », « Arrêt du 8 janvier 1775, qui accorde des gratifications pour l’importation des chevaux et mulets propres au labour dans les provinces affligées de l’épizootie », « Arrêt du 30 janvier 1775, qui prescrit de nouvelles dispositions pour arrêter les progrès de la maladie épizoo-tique », « Arrêt du 29 octobre 1775, prorogeant pour un an les gratifications accordées à l’importation des mulets et des chevaux propres à la charrue dans les provinces affligées de l’épizootie », « Arrêt du 1er novembre 1775, concernant l’exécution des mesures ordonnées par le Roi pour arrêter les progrès de la maladie épizootique dans les Provinces qui en sont attaquées ».
[66] « Arrêt du 29 avril 1776, qui établit une Correspondance médicale pour tout ce qui a rapport aux maladies épidémiques ou épizootiques. »
[67] EdJ, mars 1777, p. 61-71.
[68] J.-B.-L. Brayer de Beauregard, L’honneur français, ou, Tableau des personnages qui, depuis 1789 jusqu’à ce jour, ont contribué à quelque titre que ce soit, à honorer le nom français, t. II, Paris, Léopold Collin, 1808, p. 52.
[69] Correspondance littéraire : adressée à Son Altesse impériale Mgr. le grand-duc, aujourd’hui empereur de Russie, et à M. le comte André Schowalow, chambellan de l’impératrice Catherine II, depuis 1774 jusqu’à 1789, t. II, Paris, Migneret, 1801, lettre LX, p. 42.
[70] EdJ, octobre 1782, p. 65-86 et novembre 1782, p. 91-109.
[71] Voir Le sain et le malsain, Dix-huitième siècle, n° 9, 1977.
[72] EdJ, décembre 1782, p. 82-99.
[73] EdJ, janvier 1783, p. 189-211.
[74] Ouvrage de J.-G. Boutrolle, augmenté par J.-M. Coupé (1737-1809).
[75] Voir D. Droixhe, Le marché de la lecture dans la Gazette de Liège à l’époque de Voltaire. Philosophie et culture commune, Liège, Vaillant-Carmanne, 1995, p. 92-95 (rééd. Liège, SWEDHS, 2011, en ligne sur www.swedhs.org).
[76] Loc. cit.
[77] EdJ, août 1785, p. 342-359 ; septembre 1785, p. 349-352 et p. 354-358. L’Instruction sur les moyens de suppléer à la disette des fourrages, et d’augmenter la subsistance des bestiaux paraît dans l’EdJ avec un décalage important, difficilement explicable vu l’urgence du sujet. Le Journal politique ou Gazette des Gazettes publié à Bouillon, par exemple, l’a déjà reproduite dans son numéro de la seconde quinzaine de juin et le Journal encyclopédique dans celui de Juillet.
[78] EdJ, août 1786, p. 132-133.
[79] Cours complet d’agriculture, t. VIII, Paris, 1789, p. 485, n. 1.
[80] EdJ, février 1775, p. 189-195.
[81] Dans le même numéro, l’EdJ reproduit l’« Épître à M. de Voltaire, sur un pain qu’il avait composé avec des pommes de terre » de Barthélemy Imbert (février 1775, p. 245-246).
[82] Voltaire, « Lettre XXVI à M. Parmentier », Œuvres complètes, Imprimerie de la Société littéraire typographique, 1784, p. 45.
[83] Antoine Augustin Parmentier, Recherches sur les végétaux nourrissants, qui, dans les temps de disette, peuvent remplacer les aliments ordinaires, avec de nouvelles observations sur la culture des pommes de terre, Paris, Imprimerie royale, 1781, p. 440.
[84] EdJ, février 1779, p. 340-343.
[85] EdJ, juin 1779, p. 90-98.
[86] Ibid., p. 336-341.
[87] EdJ, juillet 1780, p. 339-355.
[88] EdJ, octobre 1781, p. 94-108.
[89] EdJ, octobre 1786, p. 357-3588.
[90] EdJ, mars 1787, p. 395-399.
[91] EdJ, septembre 1787, p. 351.
[92] EdJ, septembre 1788, p. 179-187.
[93] EdJ, juin 1789, p. 89-102.
[94] Voir notre communication sur « Les traductions d’ouvrages anglais dans l’Esprit des journaux », Atelier « Traduction » organisé par le groupe de recherches sur l’histoire intellectuelle (EA 1569), Université Paris 8 dans le cadre du réseau ANR « transferts culturels », 29-30 mai 2009.
[95] EdJ, octobre 1776, p. 57.
| |



|




