

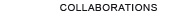


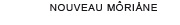


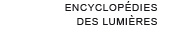
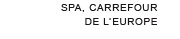
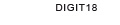
|
|
E-bibliothèque > Articles
« Entre deux eaux ».
Les secondes Lumières et leurs ambiguïtés (1789-1815) :
introduction au colloque
de Poitiers[*]

Par ANOUCHKA VASAK
Des circonstances géographiques, autant qu’un intérêt scientifique commun aux membres du Réseau Lumières dont le présent ouvrage est l’émanation, ont rassemblé historiens et littéraires autour d’un moment historique et d’un objet sur lequel l’histoire littéraire française, toujours prompte à opérer des découpages et à tracer des frontières, ne s’attarde sans doute pas suffisamment : l’entre-deux siècles, en l’occurrence la période que certains historiens ont nommée « secondes Lumières ». Ce réseau sans frontière — il est lié au Groupe d’études du dix-huitième siècle de l’université de Liège, et a su attirer hors de notre territoire régional de nombreux chercheurs —, a vu le jour entre Loire et Vienne, entre deux fleuves : une situation géographique « entre deux eaux » qui a guidé notre réflexion et nous a conduits à nommer la période considérée comme un moment de transition, d’ambiguïté peut-être, d’hybridation aussi, propre à générer doutes et conflits, d’où sortira une modernité qu’il nous faudra pourtant définir : tant le mot, galvaudé et propice au malentendu, peut sembler a priori inadéquat pour évoquer ce moment historique qui nous apparaît aujourd’hui, sous certains aspects significatifs, comme un « dos tourné » au présent et à la politique.
C’est par le biais de la langue que nous nous proposons de préciser notre objet — ou, si l’on veut s’en tenir à la règle scolaire, d’analyser notre sujet. On s’arrêtera ici sur deux notions dans lequel il tient: celle du « deux » (entre deux eaux, secondes Lumières, ambiguïtés), celle de la préposition « entre ».
Qu’entend-on par « secondes Lumières » ? Sans doute l’expression, qui nous paraît relativement récente et, en France, propre aux historiens de la littérature ou des idées plus qu’aux historiens et aux philosophes, est-elle loin d’être admise dans tous les pays européens où les Lumières sont une réalité historique et un concept. Second Enlightenment ou zweite Aufklärung réfèrent à un mouvement spirituel qui dit assumer les acquis de la science mais les intégrer dans une perspective religieuse : en aucun cas l’expression ne renvoie à ce moment historique circonscrit à la fin du 18e et aux premières années du 19e siècle, avant 1830 quoi qu’il en soit, et jusque en 1815 pour être exact. C’est dans un article paru en Italie en 1998 que l’expression « secondes Lumières » se voit réellement conceptualisée sous la plume de Michel Delon[1] : elle fonde une interrogation sur les limites du dix-huitième siècle, limites qui en effet ont toujours posé problème aux histoires littéraires scolaires. Faut-il privilégier la chronologie historique, faire débuter le 18e à la mort de Louis XIV, et l’arrêter en 1789 au motif de la coupure révolutionnaire ? Faut-il au contraire considérer que le siècle des Lumières, comme jadis Paul Hazard nous y invitait, commence avec la crise de la conscience européenne de la fin du 17e ? Faut-il le prolonger jusqu’à l’Empire ? Mais l’expression « secondes Lumières », selon l’auteur de L’Idée d’énergie au tournant des Lumières (1770-1820), désigne aussi ledit tournant comme un moment de crise, contemporain, en ses débuts du moins, du Sturm und Drang. À la vérité, l’expression « secondes Lumières » a été employée dès 1989 par Jacques Domenech dans L’Éthique des Lumières[2], et même en histoire religieuse par Jean Godel et Bernard Plongeron dans un article de 1972[3]. Plus récemment, elle a été employée furtivement par Georges Benrekassa dans sa contribution à l’ouvrage collectif dirigé par Didier Masseau sur Les Marges des Lumières françaises[4], ouvrage qui traite de la seconde moitié du 18e siècle. On la trouve également dans le livre de Frédéric Barbier, Lumières du Nord, paru en 2002[5] : dans l’histoire du livre, les « secondes Lumières » renvoient à la « seconde révolution », seconde par rapport à celle introduite par Gutenberg, mais antérieure à la Révolution française, car apparue dans les années 1760.
La période qui nous retient, étant entendu que, on le voit, les limites chronologiques n’en sont pas clairement définies, a reçu d’autres dénominations, celle de « tournant des Lumières » que nous venons d’évoquer, celle aussi de « Lumières tardives » : l’expression est une traduction de l’allemand « Spätaufklärung », reprise à son compte par Jean Deprun dans son ouvrage la Philosophie de l’inquiétude en France au XVIIIe siècle, paru en 1979. La grande originalité de cet ouvrage est pourtant de ne pas limiter l’inquiétude à une donnée caractéristique de la fin des Lumières, de ne pas la cantonner à la période jadis appelée « préromantique », catégorie dont les historiens de la littérature ont montré l’inefficacité. Une question peut dès lors se poser. Et s’il fallait entendre « secondes Lumières » dans un sens non plus chronologique, ou du moins exclusivement chronologique, et y voir plutôt un mouvement souterrain qui doublerait ou réfléchirait continument la lumière trop éclatante de la raison ? Mais si les « secondes Lumières », ou ces « Lumières secondes » croisent nécessairement le romantisme allemand[6], voire les « anti-Lumières[7] » ouvertes par Herder et Burke dans leurs distances prises avec la raison, avec l’universalisme et la notion d’autonomie de l’individu, elles ne constituent pas un mouvement — tout au plus désignent-elles un champ en friches ou de bataille, celui laissé en France et dans une partie de l’Europe par la Révolution. Et ce, même si ce moment participe aussi, notamment avec la mouvance des Idéologues, des Lumières. Aux secondes Lumières on peut, dans une certaine mesure, appliquer l’analyse de l’Aufklärung que donna Michel Foucault dans « Qu’est-ce que les Lumières ? », en écho à la fameuse brochure de Kant :
Il ne faut jamais oublier que l’Aufklärung est un événement ou un ensemble d’événements et de processus historiques complexes, qui se sont situés à un certain moment de développement des sociétés européennes. Cet ensemble comporte des éléments de transformations sociales, des types d’institutions politiques, des formes de savoir, des projets de rationalisation des connaissances et des pratiques, des mutations technologiques qu’il est difficile de résumer d’un mot[8].
Sous ce rapport, les secondes Lumières relèvent encore des Lumières, pour autant que, à la suite de Foucault, on entende celles-ci, premières ou secondes, comme un régime permanent de la critique qui serait celui de la modernité. Modernité ? Si, suivant encore Foucault, on la définit comme « un mode de rapport réflexif au présent », un « mode de relation à l’égard de l’actualité[9] », que faire de ce « dos tourné » au présent, qui caractérise certaines œuvres de fiction ? Victoire Feuillebois montre dans ce volume comment et pourquoi Goethe, dans les Entretiens d’émigrés allemands (1795), a fait le choix du conte et de l’irrationnel ; de même, Francesco Schiariti souligne que la diégèse du roman de cour sous le Consulat et l’Empire s’inscrit « dans un temps où la Révolution ne peut pas avoir eu lieu ». Précisément, ces manières de déni peuvent être interprétées comme des réponses au traumatisme révolutionnaire, mode encore « de relation à l’égard de l’actualité ». Le romantisme, le mal du siècle s’en nourriront, et le Voyageur au-dessus d’une mer de nuages de Friedrich fixera, en 1818, le paradigme du dos tourné.
C’est pourquoi nous n’avons pas décidé a priori, ni ne déciderons a posteriori, de la définition idéologique ou philosophique des secondes Lumières. Nous n’avons pas cherché à identifier formellement, dans l’ordre des représentations, les prémices d’une esthétique romantique, ou, dans l’ordre des idées, les marques des anti-Lumières : même si l’expression a pu être employée à propos de la physico-théologie de Bernardin de Saint-Pierre, dans laquelle Guilhem Armand, démontant l’idée convenue du finalisme naïf de l’auteur des Etudes de la nature, voit une transition entre Lumières et romantisme ; même si encore, le récit de voyage de Volney et Chateaubriand se situe bien entre Lumières et romantisme : mais Istvan Cseppentö montre comment au-delà du genre « récit de voyage », c’est la notion même de voyage et le statut de l’auteur qui se voit modifié. À la vérité, notre dessein était, à la faveur de l’interdiscipline, d’éviter la partition entre représentations esthétiques et idées, entre fiction et prose d’idée. Le colloque de Poitiers, dont sont ici rassemblées les contributions des historiens et des littéraires, a donc avant tout cherché à explorer une période. Sous cet angle, les formes de mutation et transition, qui génèrent aussi contradictions et conflits, la dominent comme des constantes repérables dans des champs très divers. Bon an mal an, et malgré des parenthèses historiques comme celle, inédite dans l’histoire religieuse, de l’Église constitutionnelle, analysée par Fabrice Vigier pour le département de la Vienne, c’est bien du nouveau qui sortira de la situation contradictoire née de la Révolution.
Voilà pourquoi la préposition « entre » dans cet entre-deux historique, dans cet entre deux eaux, revêt tout son sens ; et ce sens apparaîtra à qui prendra la peine de lire la totalité des articles du présent volume. « Entre[10] » signifie toute l’ambiguïté de la période, celle d’un « intervalle » temporel qui impose aussi des échanges et des rencontres entre des cadres anciens — personnel politique, religieux ou intellectuel, autant que structures ou formes génériques — et des circonstances nouvelles.
Les conditions objectives de la production littéraire devaient être posées. Apparaissent aussitôt les premières ambiguïtés du moment : comme nous l’apprend Françoise Weil, si les permissions tacites se multiplient dès la fin des années soixante-dix, si la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme la liberté d’imprimer et la constitution de l’an I (1793) celle de la presse, cette liberté n’est pas appliquée dans les faits, même entre 91 et 93. L’éclairage apporté par Véronique Sarrazin révèle le malaise des imprimeurs-libraires angevins pour la période révolutionnaire mais aussi consulaire : soumis aux vicissitudes de la censure (supprimée, réintroduite dans des conditions très variables selon les régimes), ils ne peuvent mettre en œuvre la révolution éditoriale qu’appelle pourtant la chute de l’Ancien Régime. Mais les mutations du monde du livre, tant au niveau de la production que des habitudes de lecture, génèrent aussi des pratiques littéraires nouvelles, comme celle de la suite littéraire : Antonia Zagamé y décèle un nouveau rapport à l’œuvre, et au genre littéraire. La période impose par ailleurs des torsions significatives à une entreprise éditoriale monumentale, celle de l’Histoire des deux Indes : Daniel Droixhe analyse les différences idéologiques entre l’édition de 1780, où l’influence de Diderot est sensible, et celle de 1820, établie à partir des manuscrits de Raynal et marquée par un esprit d’entreprise colonialiste. Dans un genre différent, l’opéra de Guillard, les Horaces, adapté de la pièce de Corneille, a une tout autre résonance politique en 1800 et en 1786, comme en témoigne, analysée par Laurine Quetin, la signification symbolique du serment des Horaces, qui a pu être perçue comme une marque d’allégeance au premier Consul en 1800, et non plus comme porteur de ce message patriotique que la Révolution verra dans le tableau de David exposé en 1785. Les œuvres ne gagnent pas toujours à ces réécritures : le second Horace a perdu en énergie et lyrisme, le second Barbier de Séville, opéra bouffe de Paisiello en 1782 — qui bien avant celui de Rossini remporta un énorme succès — étudié par Suzel Esquier, revient à une tradition comique qui évite toute polémique mais perd une bonne part de la charge du Barbier de Beaumarchais (1775). La période produit aussi des formes hybrides, des « monstres littéraires », selon la formule de Catherine Ramond : ces formes hybrides que sont le Drame de la vie de Rétif de la Bretonne ou la Ruse d’amour ou les six spectacles de Sade porteraient même en germe un « refus du genre » dont le romantisme fera une revendication esthétique. Jean-Noël Pascal pointe quant à lui la poésie comme le lieu d’un conflit que le contexte politique des premières années du 19e siècle exacerbe dans ses institutions savantes, au premier chef à l’Institut : de ce conflit entre un classicisme en voie de fixation par l’Empire et le désir d’un renouvellement poétique émergeront à la fois l’« establishment littéraire » et une poésie lyrique aux accents subjectifs inédits.
Sur ce chemin entre Lumières et romantisme, entre Révolution et Empire, on croise des figures oubliées mais passionnantes par ce qu’elles révèlent du goût dominant de l’époque, comme les poètes Victorin Fabre ou Antoine Jay. On croise aussi Sade, Bernardin de Saint-Pierre, et peu après Chateaubriand. Mais certains itinéraires individuels éclairent parfaitement les zones troubles traversées. C’est le cas de Madame de Duras, dont Cécile Charpentier étudie le changement de statut et d’image, révélateur de la situation de la femme, et singulièrement de la femme auteur : sous l’effet du succès de ses romans et notamment d’Ourika, Claire de Duras, dont les écrits n’étaient a priori pas destinés à dépasser la renommée de son salon, en vient à assumer sa condition d’auteure. Autres itinéraires remarquables, ceux de quelques intellectuels parfois appelés à un rôle politique : le Flamand Charles Joseph Lambrechts, dont Bruno Bernard retrace la carrière — d’abord joséphiste, il accueille avec enthousiasme le 18 Brumaire, prendra ses distances avec Napoléon et deviendra républicain. Ou Claude Fauriel, qui a eu un rôle déterminant, révélé par Jean-Jacques Tatin-Gourier, dans les transferts culturels avec la Grèce, mais aussi de passeur entre les Idéologues et les premiers historiens de la Révolution ; par ailleurs, son itinéraire est significatif, sous l’effet d’une prise de conscience du rôle de Bonaparte dans le gauchissement du régime républicain, d’un renoncement à la politique, peut-être caractéristique de la période aussi, au profit des études littéraires. Enfin, on se penche sur le cas de Dupont de Nemours, dont Lucia Bergamasco analyse la correspondance avec Thomas Jefferson, entre 1800 et 1816 : elle révèle le passage hautement problématique entre la pensée et sa réalisation, entre les principes physiocratiques en matière d’économie agricole ou d’éducation de la petite enfance, et leur concrétisation dans la jeune république des États-Unis. Comment expliquer le silence de Jefferson, esprit ouvert et novateur ?
Zone trouble disions-nous, que symbolise à merveille l’image de la tempête utilisée par les premiers historiens de la Révolution, image dont Olivier Ritz déploie toutes les ambiguïtés. Lieu commun, l’image de la tempête prend pourtant un sens qui révèle la difficulté à caractériser l’époque troublée, notamment dans l’Essai sur les révolutions de Chateaubriand : conception cyclique de l’histoire, ou sentiment d’une rupture radicale ? Par ses hésitations entre 1797, première version du texte, et 1826, où il fait figurer l’Essai en tête de ses œuvres complètes, Chateaubriand exprime toute l’incertitude de la période, et la nécessité d’un langage nouveau. Entre le dos tourné au présent — « la Révolution a chassé de mon esprit le monde réel en me le rendant trop horrible», dira Joseph Joubert, ami de Chateaubriand, en 1802 —, et « l’aurore splendide » saluée par Hegel, l’époque se cherche, les voix se mêlent et se contredisent. Mais chacun semble y reconnaître ce que Goethe dit à propos de la bataille de Valmy, et que rappelle Victoire Feuillebois : « De ce lieu et de ce jour date une nouvelle époque dans l’histoire du monde ». Aurore ou crépuscule ? Le spectateur du fameux tableau de Friedrich hésite. Cette hésitation est celle-là même des secondes Lumières.
[*] Paru dans Anouchka Vasak (dir.), Entre deux eaux les secondes Lumières et leurs ambiguïtés (1789-1815), Le Manuscrit, coll. «Réseau Lumières», 2012.
NOTES

[1] Michel Delon, « Les secondes Lumières en France », Studi francesi 224, Torino, Sozzi, 1998.
[2] Jacques Domenech, L’Éthique des Lumières. Les fondements de la morale dans la philosophie française du XVIIIe siècle, Paris, Vrin, 1989.
[3] Jean Godel et Bernard Plongeron, « 1945-1970. Un quart de siècle d’histoire religieuse. A propos de la génération des “ secondes Lumières ” (1770-1820) », Annales historiques de la Révolution française, 1972.
[4] Didier Masseau (dir.), Les Marges des Lumières françaises (1750-1789), Genève, Droz, 2004.
[5] Frédéric Barbier, Lumières du Nord. Imprimeurs, libraires et «gens du livre» dans le Nord au XVIIIe siècle (1701-1789). Dictionnaire prosopographique, Genève, Droz, 2002.
[6] Voir l’ouvrage de Pierre-Henri Tavoillot, Le Crépuscule des Lumières, Paris, Cerf, 1995.
[7] Voir l’ouvrage désormais classique de Zeev Sternhell, Les anti-Lumières. Du XVIIIe siècle à la guerre froide, Paris, Fayard, 2006.
[8] Michel Foucault, « Qu’est-ce que les Lumières ? », Dits et écrits, tome IV, Paris, Gallimard, 1994.
[9] Ibid.
[10] « ENTRE. Du latin inter, préposition signifiant “ entre, parmi, au milieu de ” et servant aussi à marquer des relations d'échange, de réciprocité, etc. », Dictionnaire de l’Académie française, neuvième édition. | |



|




