

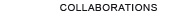


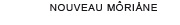


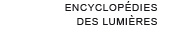
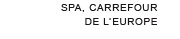
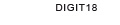
|
|
Visiteurs à Spa > L'Avant-Coureur spadois
N° 6. spa
au 18e siècle :
Les chemins croisÉs
de l’Écriture

par DANIEL DROIXHE
Spa, ce « café de l’Europe », selon la formule consacrée, vit défiler de nombreux écrivains et écrivaines de toutes nations. Mon intention n’est pas ici d’en dresser la galerie à partir des Listes des seigneurs et dames qui enregistraient, dans la seconde moitié du 18e siècle, l’arrivée des visiteurs et fournissaient leur lieu de résidence. On s’est de préférence attaché à quelques-uns des destins croisés que dessinent ces séjours, selon des figures qui peuvent prendre des formes diverses : interaction plus ou moins longue avec le milieu local, rencontres décisives, exercice d’une sociabilité donnant à l’échange une portée particulière, accidents produits par les jeux de l’amour et du hasard, etc. Le cadre s’y prêtait à merveille. Comme l’écrit le baron de Trenck dans ses Mémoires, traduits par lui-même sur l’original allemand, parus en 1789[1] : « La vie qu’on mène à Aix-la-Chapelle et à Spa fut assez de mon goût. On y voit des hommes de tous les rangs, de tous les pays : on y voit même des princes souverains, qui, pour ne pas vivre entièrement isolés, sont obligés de se plier à rechercher la société des gens de toutes les conditions. Le matin, je m’entretenais chez moi avec un lord de l’opposition ; et l’après-midi, avec un ami de la cour et un orateur du parlement… »
Frédérick de Trenck fut sans doute un des écrivains qui fut le plus à même d’évoquer — même s’il ne l’a pas fait — la chronique de la vie spadoise dans la seconde moitié du 18e siècle. Ne dit-il pas qu’il passa dans la cité ardennaise, « pendant seize années consécutives », « la plus grande partie des étés » de sorte que sa maison devint « le rendez-vous de toutes les personnes de distinction, ou qui se piquaient de probité[2] » ? Il y avait trouvé refuge après avoir passé une dizaine d’années dans les geôles du roi de Prusse, pour avoir séduit la sœur de Frédéric II, la princesse Anne-Amélie. Le frontispice des Mémoires du baron évoque sa longue incarcération.

Un téléfilm allemand de 2003, Trenck - Zwei Herzen gegen die Krone, a scellé son aventure dans la mémoire collective. Une fois sorti des cachots de Magdebourg, Trenck est bien décidé à profiter de la liberté retrouvée. Il raconte[3] : « Je me déterminai à quitter Vienne, à chercher un coin de terre où, loin des cours et des monarques, à l’abri des attentats de la calomnie, et des fureurs du pouvoir arbitraire, je pusse vivre dans une obscure tranquillité. Le grand monde, les sociétés nombreuses m’étaient insupportables. »
Il est curieux de le voir dès lors espérer une « obscure » retraite aux eaux d’Aix-la-Chapelle, puis de Spa. Choix heureux : « En un seul jour, j’y ai rencontré plus d’égards, plus de plaisirs, plus d’amis que je n’en ai trouvé à Vienne dans tout le cours de ma vie. » Si l’on considère les dates des séjours avérés, que l’on a tâché de cartographier, il a pu croiser, sinon rencontrer, les personnalités les plus diverses et recueillir les rumeurs les plus piquantes.

Logements identifiés du baron de Trenck à Spa de 1765 à 1774.
En 1767, quand il descend à l’hôtel de l’Anneau d’or, dans l’ancienne rue de l’Assemblée, qu’un grand incendie, en 1807, et un urbanisme prétentieux ont dévastée — c’est aujourd’hui la rue Royale —, il est n’est pas loin de la Cour de Manheim, où s’installera la même année Marmontel en compagnie du marquis de Marigny, frère de la marquise de Pompadour[4]. Le premier allait rendre visite à l’imprimeur liégeois Jean-François Bassompierre, qui en profitera pour proposer à l’écrivain, membre de l’Académie française, de s’installer à son domicile du Môriåne. Ce qu’il écrirait serait, promettait Bassompierre, imprimé dès le lendemain — on ne doutait de rien, alors, à Liège. Il se vit offrir une édition du théâtre de Molière qui lui coûta « dix mille écus », en comptant le manque à gagner des contrefaçons des Contes moraux ou du Bélisaire réalisées dans l’atelier de la rue Sainte-Catherine[5]. Les deux hommes avaient été précédés à Spa, deux semaines plus tôt, par Madame de Marigny et la marquise de Séran dont on espérait, paraît-il, qu’elle imposerait ses charmes auprès du roi, toujours en attente de nouveautés. Il est vrai que Louis XV avait délaissé la Pompadour depuis une bonne quinzaine d’années… Pour le marquis de Marigny, un clou, si l’on ose dire, eût chassé l’autre.

Inscription de Marmontel et du marquis de Marigny dans la Liste des seigneurs et dames qui sont venus aux Eaux Minérales de Spa, l’an 1767. A Liège et à Spa, Chez F. J. Desoer.
En 1768, Trenck descendit à la Main d’or, en un modeste immeuble qui a échappé aux bouleversements architecturaux.

Ancien hôtel de la Main d’or, aujourd’hui rue Xhrouet, n° 27
(cliché M. Collart).
Il a le choix, pour bavarder du Nouveau Monde, entre Henry Ellis, « gouverneur de la Nouvelle Écosse[6] », un des habitués de Spa, et Philippe Fermin, Maastrichtois qui a déjà donné une Histoire naturelle de la hollande équinoxiale. Celui-ci s’apprête à publier une Description de la colonie de Surinam qu’il vient en quelque sorte présenter à Spa en 1769[7]. Il y développe, en faveur de la légitimité religieuse de l’esclavage des Noirs, la thèse qui rendra célèbre sa Dissertation de 1770 sur la question s’il est permis d’avoir en sa possession des esclaves et de s’en servir comme tels, dans les colonies de l’Amérique. On imagine sans peine le débat qui eût pu s’instaurer entre les deux hommes — si l’écart séparant les moments d’inscription dans les Listes des seigneurs et dames en autorisait la possibilité. La mise sur le marché de l’Histoire des deux Indes de l’abbé Raynal s’en fera d’une certaine manière l’écho.
Mais Trenck pouvait surtout, cette année-là, croiser un personnage qui défraiera la chronique spadoise peu après. Pour l’instant, « Monsieur le Comte Alfieri, de Turin », se fait discrètement inscrire le 2 août, quelques jours après Trenck, à l’hôtel de la Croix blanche. Les mémoires du grand dramaturge italien le montrent en quelque sorte jetant sa gourme. Il n’a pas vingt ans. Il quitte en juin Londres pour la Hollande, « pays agréable et riant », remarquable par « sa population, sa richesse, sa propreté, la sagesse des lois, les merveilles de l’industrie et de son activité[8] ». Il raconte : « Pendant mon séjour à La Haye, qui dura bien plus longtemps que je me l’étais promis, je tombai finalement dans les rets de l’amour, qui jusque-là n’avait jamais pu me rejoindre et m’arrêter. Une jeune femme charmante, mariée depuis un an, pleine de grâces naturelles, d’une beauté modeste et d’une douce ingénuité toucha profondément mon cœur. Le pays était petit, les distractions rares ; en la voyant beaucoup plus souvent que d’abord je ne l’aurais voulu, j’en vins bientôt à me plaindre de ne pas la voir assez… »
Gustave Charlier a cru pouvoir identifier cette jeune femme avec Catherine Elisabeth van Hasselaer, « fille d’un des personnages politiques les plus importants des Provinces-Unies, plusieurs fois bourgmestre d’Amsterdam, amiral général, ministre plénipotentiaire au congrès d’Aix-la-Chapelle[9] ». Âgée de vingt-huit ans, celle-ci avait effectivement, jeune veuve, épousé en 1767 le marquis François Gabriel Joseph du Chasteler (Mons, 1744-Liège, 1789). On trouve inscrits parmi les hôtes de Spa, arrivés le même jour qu’Alfieri, « Monsieur le Marquis du Chasteler, Chambellan Actuel de Leurs Majestés Impériales et Royales, avec Madame la Marquise son Épouse, à l’Hôtel de Pologne[10] ».
Le marquis du Chasteler est bien connu comme membre de l’Académie impériale et royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, qu’il dirigera de 1781 à 1784 et de 1786 à la Révolution[11]. Celui que Madame de Charrière qualifiait de « sot dans toute l’énergie du terme » — en dépit d’une production scientifique abondante — va montrer à l’égard de son épouse une relative complaisance.
Alfieri, persuadé qu’il lui « serait complètement impossible de vivre sans cette femme », en fit le siège et ne tarda pas, comme il dit, à être « payé de retour ». « Le mari de ma maîtresse était un personnage fort riche, dont le père avait eu le gouvernement de Batavia » : en fait, il avait surtout hérité, de ce père, engagé dans l’administration de la fructueuse « Compagnie des Indes orientales », d’une fortune qu’il s’employa à dilapider. Alfieri poursuit son récit : « Au mois d’août, il fit avec sa femme un petit voyage aux eaux de Spa, où je les suivis de près, car le digne homme n’était guère jaloux. » L’écrivain ne manqua pas d’en profiter. Puis il fallut se séparer. Après dix jours de retrouvailles, l’amie lui fit remettre « une petite lettre de sa main » — « le coup de la mort » : « elle m’y annonçait qu’elle ne pouvait plus, sans scandale, différer de se rendre auprès de son mari, qui lui avait commandé de le rejoindre ». Alfieri fit l’expérience d’une douleur qui ne tardera pas à le tourmenter à nouveau. « Peut-être douterait-on de ma véracité si je racontais toutes les folies que m’inspira mon âme au désespoir ; en un mot, je voulais absolument mourir, mais je n’en dis mot à personne… »
Les amusantes Archives historiques et littéraires du Nord de la France, et du Midi de la Belgique, d’Aimé Leroy et Arthur Dinaux (1834), rapportent, à propos du mariage du marquis du Chasteler et de la fille du bourgmestre d’Amsterdam, des circonstances qui éclairent leurs rapports d’un jour particulier[12]. Alphonse Wauters les résume comme suit dans la Biographie nationale de Belgique[13]. D’emblée, en effet, la nouvelle alliance attira au marquis « de graves embarras » : « Informé que la future était protestante, l’archevêque de Malines voulut obliger Monsieur Du Chasteler à solliciter une dispense de la cour de Rome et à s’engager à élever dans la religion catholique les enfants qui lui naîtraient, mais le marquis refusa de souscrire à ces exigences. Avec l’assentiment du gouverneur général, le prince Charles de Lorraine, il alla se fixer en Hollande pendant six mois, afin de pouvoir y contracter mariage. L’archevêque réclama : auprès du gouvernement de Bruxelles d’abord, puis auprès de Marie-Thérèse : mais ses observations furent très mal accueillies… »
Le pape, finalement, valida le remariage, lequel ne fut pas heureux, car les époux se séparèrent une dizaine d’années plus tard, la marquise consentant à payer au marquis, qui se retira en Hollande, « une rente viagère de cinq mille florins ». C’était acquitter, en quelque sorte, la dette due à un homme qui avait bravé coup sur coup les foudres de Rome et le cocuage de Spa. Les avanies, au reste, ne l’épargnèrent pas. En considérant celles que lui attirèrent ses prétentions nobiliaires, écrivent les auteurs des Archives historiques et littéraires du Nord de la France, « c’est avec étonnement que l’on parcourt la nombreuse liste de ses ouvrages, et l’on se demande comment il put trouver le temps de soutenir ses discussions de famille tout en rédigeant ses mémoires scientifiques, mémoires qui feront vivre son nom plus longtemps qu’une couronne ducale ou le titre de prince ! ».
Revenons à Alfieri. L’année 1770 le fait voyager en Allemagne avant de retrouver Spa, une fois « rassasié de toute espèce de tudesquerie » : « ce lieu m’avait toujours laissé le désir de le revoir avec le cœur libre[14] ». « La vie qu’on y mène me semblait devoir convenir à mon humeur, parce qu’on y trouve tout ensemble le bruit et la solitude, et que l’on peut y rester inconnu, ignoré, au milieu des réunions publiques et des fêtes ; et, en effet, je m’y trouvai si bien que j’y demeurai depuis la mi-août jusqu’à la fin septembre ? C’était beaucoup pour moi, qui ne pouvais jamais m’arrêter nulle part. J’achetai à un Irlandais deux chevaux, ont l’un était d’une beauté peu commune, et je m’y attachai vraiment de cœur. Montant à cheval du matin au soir ; dînant en compagnie de huit ou dix étrangers de tous pays ; regardant danser, le soir, de gracieuses femmes ou demoiselles, je passais (ou plutôt je consumais) mon temps le mieux du monde. »
Alfieri s’inscrit à Spa le 16 août 1770. « Mais la saison s’étant gâtée, et la plupart des baigneurs commençant à s’en aller », il décide de retourner en Hollande, en passant par Liège, « tantôt à pied, tantôt à cheval ». Il est présenté à Charles d’Oultremont : « Si je n’avais pas vu la fameuse Catherine II, je verrais du moins la cour du prince de Liège »… Dans ses Mémoires, le souvenir lui en rappelle qu'il dîna aussi, « fort joyeusement et fort bien », avec « un autre prince de l’Église, plus microscopique encore », l’abbé de Stavelot. Puis le voilà à Bruxelles, Anvers, Rotterdam et La Haye. Un nouveau chapitre de ses Mémoires va s’ouvrir, qui s’intitule Deuxième et terrible piège amoureux. Il s’éprendra à Londres d’Eléonore Pitt, épouse du comte Ligonier, et la séduira. « Pénélope », commentait autrefois Camille Henriot, « n’était en effet qu’une gourgandine, et Alfieri reçut de sa bouche même l’aveu qu’avant lui elle avait eu une liaison avec un palefrenier » : « Lady Chatterley ne serait donc pas une exception dans la gentry[15] ». Mis au courant, le mari provoquera Alfieri en duel, sur la pelouse de Green Park. On ne voit donc pas sur quoi se fonde la pieuse tradition selon laquelle l’écrivain se serait battu « lors de ce second séjour » à Spa[16]. Au demeurant, on n’enregistre pas la présence, en 1770, du couple Ligonier.
On peut jouer avec les temps et les lieux. Quand Alfieri arrive à Spa, dans la deuxième quinzaine du mois d’août, les hôtes dignes d’intérêt se bousculent au bureau du libraire Desoer pour se faire inscrire sur ses Listes. Voici, à la Couronne d’épines, « l’anguillard » de Voltaire, « Monsieur Needham », ainsi nommé pour sa théorie de la génération spontanée à partir d’animalcules ressemblant à des anguilles[17]. Est-ce bien Anacharsis Clootz, l’orateur du genre humain, qui s’inscrit à l’Anneau d’or, comme le croit Albin Body[18] ? On signale même la présence de « Monsieur Willy, Indien, au Grand Monarque[19] ». Trenck, quant à lui, est là depuis la mi-juillet[20].
Cette hôtellerie du Grand Monarque, où descend aussi Alfieri, mérite à coup sûr qu’on s’y arrête.

Hôtel du Grand Monarque, où descendent Alfieri (1770), Fragonard (1773), le baron de Grimm (1774), etc. L’établissement conservera son enseigne jusque vers 1890, selon A. Body (cliché M. Collart).
Elle se trouvait dans une des artères dont l’image nous est le mieux conservée, notamment grâce à une vue d’optique souvent reproduite.

Vue rétablie de gauche à droite de l’ancienne rue de la Grand-Place, aujourd’hui rue du Marché, d’après la vue d’optique inversée de Johann Georg Bergmuller, vers 1760.
Y logent en 1773 Fragonard, en compagnie de son mécène Pierre-Jacques-Onésyme Bergeret de Grancourt, avec lequel le peintre entreprend en octobre un célèbre voyage d’Italie[21]. Suivra en 1774 « Monsieur le Baron de Grime, Saxon[22] ». S’il s’agit bien de Friedrich Melchior Grimm, celui-ci venait d’abandonner la Correspondance littéraire et on imagine ce retraité cherchant au pouhon Pierre le Grand ou à la Géronstère le ressourcement et les rencontres qu’appelait un tempérament enclin à la galanterie.
C’est lui, en tout cas, qui est inscrit le 18 juillet 1781 comme résidant au Lion noir. Il y rejoignait le prince Henri de Prusse, frère de Frédéric II, qui l’avait invité à « passer la saison des eaux avec lui », comme il le raconte dans une lettre à Gustave III de Suède[23]. Henri de Prusse était descendu là huit jours plus tôt sous le nom d’emprunt du « comte de Oels ». Le pseudonyme était transparent. Les grands avaient cette coquetterie de se faire plus petits qu’ils n’étaient.
L’invitation, mise en contexte, ne manque pas d’une certaine malignité, pour ne pas dire de perversité. Le 19 juin était arrivé à Spa l’abbé Raynal, auréolé du prestige de l’auteur condamné pour la troisième édition de la scandaleuse Histoire des deux Indes. L’écrivain trouvera asile au pays de Liège jusqu’en septembre. On sait que les passages les plus incendiaires de l’ouvrage sont de Diderot, qui a gardé l’anonymat. Depuis le printemps, ainsi que le rapporte Laurent Versini dans la préface à la Lettre apologétique de l’abbé Raynal à Monsieur Grimm, de la plume de Diderot, « le camp des encyclopédistes se divise[24] ». « Grimm attaque l’abbé Raynal, son ancien collaborateur et son prédécesseur à la tête de la Correspondance littéraire, dans tous les salons de Paris ». Et voici le passage crucial de la présentation de Versini.
En reprochant à l’abbé du Nouveau Monde des violences contre les puissants qui sont d’un lâche si l’on suppose qu’ils ne pourront se venger, ou d’un fou, s’ils le peuvent — dilemme bien hypocrite —, Grimm, qui a déjà recueilli dans la Correspondance littéraire tant de pages de Diderot destinées aux éditions précédentes des Deux Indes, peut-il ignorer qu’il s’en prend également au philosophe ? Provocation choquante, flagornerie révoltante, qui ne peut trouver de vague excuse que dans la nécessité de protéger leur ami commun Necker dont le sort ne tient plus qu’à un fil : Maurepas le fera tomber le 19 mai.
« Diderot a enfin démasqué la fourberie et l’arrivisme de Grimm… ». « À l’ami naguère adoré, (…) il dit en face qu’il est devenu un vil courtisan, un flatteur de despotes et l’un des plus dangereux antiphilosophes. » Et c’est cet homme qu’Henri de Prusse engage à ses côtés en même temps qu’il va rechercher la compagnie de Raynal ! Grimm lui-même raconte la mise en œuvre de la rencontre, dans une lettre, toute empreinte de flatteuse onctuosité, à Catherine II. « Cinq ou six jours après mon arrivée », dit-il, « est survenu un autre pèlerin qui se prénomme Joseph, et qui, ni plus ni moins que Catherine, se prétend aussi second de son nom » : curieuse manière de désigner Joseph II, qui arrive en effet à Spa le 19 juillet sous le pseudonyme du « comte de Falckenstein » et s’installe à la Cour de Londres, autre hôtel de la Grand-Place dont l’immeuble a peut-être survécu. L’empereur va se faire inviter à dîner chez le prince en choisissant notamment pour convives, détaille Grimm, « Raynal le proscrit par Séguier, à qui Henri a rendu après Joseph les services les plus essentiels, en lui procurant un asile à Bruxelles avec tous les agréments possibles ».
Comment ne pas supposer que les propos tenus à cette occasion par les convives concernant l’ouvrage de Raynal-Diderot ne seront pas rapportés à Grimm, avec un aller-retour de Raynal à Grimm ? Les attaques des uns et des autres trouvaient leur cadre européen en la présence de Diderot à Saint-Pétersbourg, alors en visite auprès de Catherine II. Le café de l’Europe avait placé à l’hôtel de la Cour de Londres son antenne de radiodiffusion.
En remontant l’actuelle rue du Marché, on trouve immédiatement, après le Grand Monarque, le Mouton blanc, « l’une des plus célèbres et des plus importantes auberges du bourg[25] ».

L’hôtel du Mouton blanc (cliché M. Collart).

Porte de l’hôtel du Mouton blanc (cliché M. Collart).
L’immeuble a survécu, même si son état ne donne qu’une faible idée de la haute société qui s’y pressait. La plaque commémorative qui orne la façade eût mérité qu’y soit au moins mentionné, au rayon littéraire, l’abbé Morellet – l’abbé « Mords-les » de Voltaire : mords les jésuites. En 1783, il vient remercier William Petty-FitzMaurice, comte Shelburne, de la récompense obtenue pour les conseils qu’il lui avait prodigués, en matière de « liberté générale du commerce », en vue la résolution du conflit avec les colonies américaines[26]. « Ma pension obtenue, je n’eus rien de plus pressé que d’aller remercier mon bienfaiteur ; il était aux eaux de Spa, lui, sa femme et deux parentes, mesdemoiselles Vernon. Il m’avait instruit de son départ ; je me rendis à Spa, porteur des lettres de M. de Vergennes ; et j’y passai auprès de milord environ cinq semaines des mois d’août et septembre, logé chez lui et ne le quittant jamais. »

Plaque commémorative apposée sur l’hôtel du Mouton blanc
(cliché Muriel Collart).
Le rôle de Shelburne dans la préparation du traité de Paris n’empêcha pas qu’il fût révoqué par le roi George III. Il reprit du service à l’été de 1782 en tant que premier ministre, mais à nouveau, sa position d’ouverture libérale à l’égard des États-Unis le contraignit l’année suivante à démissionner. C’est donc un homme en vacance du pouvoir qui vient prendre l’air de Spa. Il allait y retrouver un membre de son cabinet, le chancelier Edward Thurlow. On n’a aucune peine à imaginer quel pouvait être le sujet de rencontres entre Thurlow et son premier ministre. Dès décembre 1783, en tout cas, ils renversèrent la nouvelle coalition. Les eaux de Spa les avaient bien requinqués.
C’est un personnage ayant davantage occupé la chronique mondaine que met en évidence la plaque commémorative du Mouton blanc mentionnée plus haut. Impénitent rival de Casanova, Armand-Louis de Gontaud, duc de Lauzun, dit « le beau Lauzun », répète exactement les déchirements et les égarements amoureux d’Alfieri après les séjours à Spa.

Le « beau Lauzun ».
Lauzun a laissé des Mémoires dont Michel Delon vient de donner une édition partielle[27]. S’y étale un tempérament qui s’enflammait successivement, et souvent victorieusement, pour les plus belles femmes du grand monde. À dix-neuf ans, il avait épousé Amélie de Boufflers, qui en avait quatorze, et une immense fortune héritée de la maréchale de Luxembourg. Toute jeune fille, Amélie avait séduit Jean-Jacques Rousseau par « une figure, une douceur, une timidité virginale », attirance que Pierre Paul Clément, dans Jean-Jacques Rousseau : de l’éros coupable à l’éros glorieux, qualifie de quelque peu « étrange[28] ». On a souvent cité, par ailleurs, le témoignage de Madame Du Deffand la présentant comme un « petit oiseau », « timide », à « l’air quelque peu effrayé », que son « beau plumage » faisait admirer de tous. Victor Du Bled, l’un des principaux rédacteurs de la Revue des deux mondes, trace en 1889 d’Amélie de Boufflers un magnifique portrait, trop long pour être reproduit ici. Retenons ici ce qu’elle inspire à ceux qu’elle fréquente, ou ce qu’elle n’inspire pas à Lauzun.
Il s’élève autour d’elle comme une clameur d’admiration et de sympathie attendrie : sans efforts, sans calcul, par la dignité de son attitude, elle obtient la considération générale, captive les amis et les indifférents, les hommes et les femmes ; seul son mari resta insensible au charme pudique de l’épouse qui l’aimait[29]…
Lauzun trouve ailleurs d’autres charmes. Mettons-le, écrivait Victor Du Bled, « aux prises avec la passion, Lauzun amoureux de pied en cap » : « mettons-le en présence de lady Sarah Lennox, de la princesse Czartoryska, les deux femmes qu’il a vraiment adorées avant de rencontrer Madame de Coigny » — faut-il préciser que toutes ces dames vinrent à Spa[30] ?
Sarah Lennox, née en 1745, était la plus jeune des quatre filles du duc de Richmond. Celles-ci ont fait en 1994 l’objet d’un livre, intitulé Aristocrats, qui, adapté en série télévisée cinq ans plus tard, a rendu le public anglais très familier de leurs destins totalement romanesques. L’auteur, Stella Tillyard, y raconte comment Sarah, présentée en 1759 à la cour, fut trouvée à son goût par le prince de Galles, fils du roi, qui dut cependant s’en détourner pour des raisons politiques. Sarah Lennox épousera en 1762 un baronet, Charles Bunbury. Après une nuit de noces placée sous le signe d’un « real dislike », l’existence matrimoniale rebuta vite la jeune femme[31]. L’aménagement du jardin, l’éducation d’un chien de berger irlandais, la conversation avec un perroquet, la broderie des mouchoirs : voilà des occupations qui lui laissent vite un sentiment de manque. Elle avoue à l’une de ses sœurs: « I must be in pursuit of something. » Viennent ensuite l’antiquomanie, les collections de bouteilles de Chine, de vases de Sèvres. Joshua Reynolds adapte son portrait et peint Lady Sarah Bunbury sacrifiant aux grâces (illustration 10). L’artiste a représenté le « sublime » d’un corps qui n’est pas complètement voilé et semble en appeler à la sensualité, tandis que la présence ostensible de l’anneau de mariage, soulignée par S. Tillyard, laisse le spectateur hésitant entre la référence à l’amour conjugal ou l’insatisfaction apportée par celui-ci.

Portrait de Sarah Lennox-Bunbury par Joshua Reynolds, entre 1763 et 1765. Art Institute of Chicago.
Lauzun va précisément combler cette insatisfaction, mais au terme d’une singulière attente. Quand il la rencontre à Paris en 1766, elle lui apparaît assez séduisante : « elle était grande, sa taille était un peu forte, ses cheveux du plus beau noir et parfaitement bien plantés ; le sein d’une blancheur éclatante, et la fraîcheur d’une rose[32] ». Une incorrigible coquetterie tempère son jugement, quand il s’exprime en public : « Elle n’est pas mal, dis-je ; mais je ne vois pas qu’il y ait de quoi tourner la tête. Si elle parlait bien français, et qu’elle vînt de Limoges, personne n’y prendrait garde. » Elle-même répond froidement aux avances de Lauzun, sur le même ton d’indifférence, comme importunée : « Je ne veux pas avoir d’amant. Jugez si je puis avoir un amant français, qui en vaut bien dix autres par le bruit qu’il fait et par les peines qu’il cause. »
Un curieux épisode linguistique va les rapprocher. Il donne une idée de goguenardise plutôt charmante du duc et vaut la peine d’être raconté[33]. « Quand tout le monde sortit de chez Madame Du Deffand, elle [Sarah] écrivit quelques mots sur un morceau de papier, et me dit en descendant l’escalier : - Lisez cela en vous couchant. – On peut imaginer avec quel empressement je rentrai chez moi ! Je lis ces trois mots anglais : I love you… Je ne savais pas un seul mot d’anglais. (…) À six heures du matin je courus moi-même acheter un dictionnaire anglais qui me confirma que j’étais aimé. »
Bref, Sarah Lennox-Bunbury finit par succomber, en s’infligeant de sévères remords. Elle décida d’avouer ses fautes à son mari, Sir Charles Bunbury, en présence d’un autre soupirant qui avait renoncé, dit-elle, à la séduire et de Lauzun. Celui-ci rapporte la scène en émule de Richardson : « Le spectacle de cette soirée me sera toujours présent : une seule chandelle éclairait une chambre assez obscure et assez sale, comme le sont presque toutes les auberges françaises. Sir Charles écrivait ; lord Carlisle, la tête appuyée sur ses deux mains, paraissait plongé dans la plus profonde rêverie. Une vieille femme de chambre anglaise qui l’avait élevé me dévorait avec les yeux de la haine, et semblait me pénétrer. Lady Sarah pleurait, et quelques larmes tombaient le long de mes joues malgré moi[34]. »
La séparation semblait inévitable. Sarah écrivit à Lauzun, de Calais, le 6 février : « Je pleure beaucoup. J’ai dit à sir Charles que j’avais un mal de tête, et il s’en contenta. » Ainsi, « moi, la plus vraie de toutes les femmes, je suis obligée de mentir et de tromper deux personnes que j’estime tant ».
La biographie de Sarah Lennox, telle qu’elle est racontée par S. Tillyard, donne une suite à ces quelques mots. Le sentiment de culpabilité, après l’aventure avec Lauzun, la précipita dans une descente où se mêlaient danse, boisson et jeu. Ainsi s’habitua-t-elle à « son nouveau rôle de femme de réputation douteuse ». Celle-ci l’accompagne quand le couple Bunbury-Lennox revient à Spa, en 1767, et s’installe aux Trois Rois, hôtel qui se trouvait à peu près au croisement de la rue du Marché et de l’ancienne rue de la Promenade de la Place, aujourd’hui rue de la Promenade de Quatre Heures[35]. C’est sans doute dans la ville ardennaise qu’est censée prendre place une scène de la série télévisée des Aristocrats, qui a pour cadre une salle de jeu[36].
« Plus romanesque, plus curieusement mouvementée, semblerait encore la passion de Lauzun pour la princesse Czartoryska », écrivait le chroniqueur de la Revue des deux Mondes. « C’est l’amour werthérien, avec ses infinis de douleur, avec ses infinis de félicité : évanouissements prolongés, accès de fièvre, convulsions de rage, de désespoir jaloux, duels, crachements de sang, aveux pleins de délicatesse, promesses de chasteté acceptées de bonne foi, subtilités de sentiments, situations extraordinaires, où, partagé entre son cœur et son caractère chevaleresque, le duc agit comme certains héros de Corneille ou de Mlle de Scudéry : rien ne manque à cette aventure, plaidoyer inconscient en faveur du droit divin de la passion. »
Michel Delon trouve d’autres mots perçants pour souligner combien, en ces dernières décennies des Lumières, « l’insatisfaction ne s’oppose plus forcément à la plénitude amoureuse », tandis qu’ « au tourniquet des amours sans lendemain succède un amour dans la durée ». « L’étreinte sexuelle ne vient que tardivement couronner la fidélité de l’amant, mais elle s’accompagne de culpabilité. » On ne peut mieux faire, à nouveau, que de citer, même longuement, l’analyse de M. Delon : « Dans ses amours, Lauzun recourt à toutes les astuces que le roman libertin a familiarisées. Il connaît des étreintes dans les petites loges de théâtre ou dans les voitures, fuit par les escaliers dérobés, souffle sur les bougies pour croiser incognito le mari qui rentre, se cache dans des armoires. Cet univers est celui des mémoires du maréchal de Richelieu et de Casanova, qui s’invente chevalier de Seingalt. Mais le récit glisse sans rupture de ton de ces aventures lestes à des amours passionnées, et des gaietés libertines aux épisodes doux-amers du sentiment. On oppose par facilité le libertinage de cour et le sentimentalisme bourgeois. Diderot est l’auteur est Bijoux indiscrets aussi bien que du Père de famille. Aussi bien que Le fils prodigue, Greuze peint des tendrons, dont il suggère la facilité à fauter. »
Si de grands personnages comme ceux mentionnés sur la plaque commémorative du Mouton blanc peuvent s’offrir les cinq étoiles, les visiteurs moins fortunés paraissent choisir un logement dans l’ancienne rue des Capucins, près du jardin où, dit-on, les mêmes promeneuses que celles du Palais Royal aguichaient le client généreux. Là descendent « Monsieur le Gendre, peintre de Son Altesse Royale le Prince Charles de Lorraine[37] » et le miniaturiste Ketterlin[38], qui s’installent tout près l’un de l’autre, en juillet 1773, au Prince Ferdinand de Prusse et au Point Jour. À quelques pas de là, le petit établissement du Général Paoli avait encore accueilli en 1770 Timoléon Gallien de Salmorenc, « clerc vagant » qui, ayant gâché ses chances en tant que copiste auprès de Voltaire, allait alors de Genève à la Hollande, avant d’être embastillé et de se retrouver sur les routes de Russie[39]. La zone d’ombre que constituent dans sa biographie les années 1768 à 1772 s’éclaire ainsi de son séjour à Spa. Il publie en 1770, à l’adresse de « Liège, aux dépens de l’Auteur », son poème didactique du Spectacle de la nature. L’amateur de bibliographie matérielle a le choix, dans l’identification de l’éventuel imprimeur liégeois s’étant chargé de l’édition, entre Bassompierre et Clément Plomteux[40].

La maison blanche ou sa voisine abritaient sans doute le modeste établissement du Général Paoli où logea en 1770 l’écrivain Gallien de Salmorenc et où il travailla peut-être à son poème du Spectacle de la nature, publié à Liège (cliché M. Collart).

Supposera-t-on qu’un autre écrivain-journaliste ayant séjourné à Spa recourut aux presses de la principauté ? Jean-Jacques Rutledge ou Rutlidge donne en 1776 l’originale de son Bureau d’esprit, peut-être écrit en collaboration avec Sébastien Mercier, sous l’adresse « Liége, Chez Boubers ».

On enregistre l’arrivée à Spa, l’année suivante, le 1er juillet, d’un « Monsieur Rutledge, Gentilhomme Anglais[41] ». Il venait alors d’être emprisonné quelques semaines, en avril, sur ordre de Sartines, ancien Lieutenant général de Police devenu ministre de la Marine, qui le libéra « en lui promettant une mission[42] ». On aimerait en savoir plus sur les rapports, avec Spa et Liège, d’un aventurier pour lequel l’intérêt vient de se raviver grâce à l’édition qu’a donnée Roland Mortier de la Quinzaine anglaise à Paris, ou l’art de s’y ruiner en peu de temps, dans la collection « L’Âge des Lumières » dirigée notamment par Raymond Trousson[43].On peut aussi de plaisir à imaginer ce qu’inspira aux amis du parti philosophique en séjour à Spa la lecture d’une comédie qui prétendait ridiculiser Diderot sous le nom de « Cocus » et qui dépeignait un d’Alembert « livide comme l’envie », à côté d’un Marmontel nommé « Faribolle » et d’un La Harpe qualifié de « petit rimailleur », de « pygmée ».
Mais le plus dru de la volée allait à Condorcet, « ce triste Marquis, au teint hâve et blême, cet être famélique, qui, à force de faire les éloges de tous nos pédants, s’est rendu un personnage parmi eux ».
On a jusqu’ici peu parlé du jeu. Il pouvait provoquer les plus spectaculaires déchéances, comme dans les célèbres planches de la Carrière du roué de Hogarth. Ceci fut illustré par un exemple demeuré célèbre. Le prince et la princesse de Guéménée jouissaient d’une fortune immense. Ils devinrent des habitués de Spa, où ils logeaient aussi au Mouton blanc. À Paris, ils habitaient, place des Vosges, la maison où demeurera Victor Hugo. Elle abrite aujourd’hui son musée, mais donne sur une impasse — comme en symbole rétrospectif. Les Guéménée étaient réputés donner à Paris des fêtes somptueuses et s’adonner au jeu avec passion. Un Liégeois, Florimond de Mercy-Argenteau, ambassadeur d’Autriche dans la capitale française, en fut témoin.

Sa Correspondance secrète avec Marie-Thérèse, d’une étourdissante vivacité, qui lui vaudrait bien une édition critique, rapporte à l’impératrice, le 15 juin 1777, l’entretien que Joseph II a accordé à Mercy-Argenteau le 28 du mois précédent[44] : « Sa Majesté m’apprit que la veille, pour céder au désir de la reine [Marie-Antoinette, dont Mercy-Argenteau observe la conduite à l’intention de sa correspondante], il l’avait accompagnée dans la soirée chez la princesse de Guéménée, qu’il avait été choqué du mauvais ton de l’assemblage des gens, et de l’air de licence qui régnait chez cette dame. Sa Majesté y avait vu jouer au pharaon ; elle avait entendu elle-même des espèces de reproches faits en présence de la reine à Madame de Guéménée sur sa façon suspecte de jouer. L’empereur était indigné de cette indécence ; il avait dit nettement à la reine que cette maison était un vrai tripot… »
On reconnaît ici la célèbre formule attribuée à Joseph II pour qualifier le logement des Guéménée, voire l’endroit où la princesse exerçait ses fonctions de « Gouvernante en survivance des Enfants de France », comme l’annonçait son inscription à Spa de 1774).

Célèbre gravure de Jean Pierre Julien Dupin, d’après Pierre-Thomas Le Clerc, représentant Marie-Thérèse Charlotte de France, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, sur les genoux de la marquise de Guéménée (Coll. de Vinck. Un siècle d'histoire de France par l'estampe, 1770-1870. Vol. 44, pièces 5943-6108, Ancien Régime et Révolution).
Le train de vie des Guéménée — et des pertes d’argent auxquelles les jeux de Spa ne durent pas être étrangers — les entraînèrent en 1782-1783 dans une faillite où ils perdirent, dit-on, la somme astronomique de 33 millions de livres. La princesse dut aussi abandonner sa charge de gouvernante, reprise par la non moins célèbre duchesse Polignac. La Polignac était aussi à Spa en 1782[45]. Le roman Les adieux à la reine de Chantal Thomas, en 2002 et le film qui en a été tiré en 2012 ont consacré dans le grand public l’amour qui l’unissait à Marie-Antoinette.
Les dégâts financiers occasionnés par les jeux préoccupaient aussi le baron de Trenck, que nous retrouvons enfin. Il raconte : « En 1771, je faisais à Aix une gazette, et la feuille hebdomadaire intitulée l’Ami des hommes », c’est-à-dire le Menschenfreund[46]. « J’y multipliais les efforts de ma raison, pour arracher à la superstition le masque dont elle se couvre ». Il y dénonçait aussi « les joueurs et les sociétés de fripon qui, en vertu des permissions de l’évêque et du magistrat, se voyaient autorisés à dépouiller indistinctement, et de la manière la plus révoltante, les étrangers et les naturels du pays…. ». On sait que le prince-évêque et les caisses liégeoises prélevaient des taxes considérables sur les sommes engagées dans les jeux de Spa : la Révolution trouvera bientôt dans ce sacré commerce une de ses origines. Trenck avait d’autres mots très durs pour l’Église locale : « J’avais prouvé que le clergé d’Aix, de Liège et de Cologne vit dans la plus honteuse ignorance, et se plonge aussi joyeusement dans le crime que le pourceau dans la fange. J’avais rappelé mes concitoyens aux seuls et véritables devoirs du Chrétien : voilà les causes qui m’ont attiré la haine irréconciliable de quelques hypocrites, véritablement indignes du ministère sacré et respectable qu’ils déshonorent sans pudeur. »
Il n’en fallait pas tant pour déclencher des hostilités auxquelles la population elle-même participa sans doute. « On a fait diverses tentatives pour m’empoisonner, mais elles ont toutes échoué, parce que je ne mangeais jamais hors de chez moi. En 1744 [lire « 1774 » ?], je fus attaqué sur la route de Spa, dans le pays de Limbourg, par huit coquins armés de gros bâtons. » Il les mettra en déroute avec le fourreau de son sabre.
Si Sarah Lennox ou les Guéménée ont dû assidument user à Spa le tapis vert, une autre visiteuse anglaise, non moins favorite des médias, a quant à elle romancé la descente dans l’enfer du jeu : Georgiana Spencer, duchesse du Devonshire, « célèbre pour sa beauté et son esprit », garantit Wikipedia, publia sous l’anonymat en 1779 The Sylph, où elle raconte le dégoût progressif que lui inspire la condition de femme mariée à un dandy volage. Ce qui se présente ici comme autobiographique ne constitue cependant pas — malheureusement pas — l’essentiel du film tiré de la vie de Georgiana Spencer, sorti en 2008 sous le titre The Duchess. Il serait indifférent que celle-ci ait passé à Spa, pour ainsi dire, une grande partie de ses vacances d’été, comme enfant et adolescente, si l’hôtel du Cornet, où sa famille séjourna régulièrement, n’était réputé un des plus animés cercles de jeux privés de la ville[47]. Se frotter aux divertissements très virils qu’y entretenait en outre le Cercle anglais ne représentait pas la meilleure formule éducative préconisée par Mesdames de Genlis ou Leprince de Beaumont. À son tour, la sœur de Georgiana, Henriette, succomba à la passion du jeu. Une toile d’Angelika Kaufmann représente en 1774 les deux jeunes filles en compagnie de leur frère (Georgiana avait vingt ans). Mais une production contemporaine ne témoigne pas moins du statut de culte atteint par Georgiana, à laquelle remontent Lady Di (Diana Spencer, pour mémoire)… mais aussi Sarah Ferguson, par une branche illégitime. Les portraits de l’ancêtre et de la victime du tunnel de l’Alma s’y confondent de manière assez convaincante.

Angelica Kauffmann, Portrait of Lady Georgiana, Lady Henrietta Frances and George John Spencer, Viscount Althorp, 1774 (Althorp, Northamptonshire, Grande-Bretagne).

Stephen Warde Anderson, Georgiana Spencer (Lady Di).
Coll. de l’artiste, Rockford, Illinois.
On imagine aujourd’hui ce que le peuple d’ancien régime pouvait ressentir devant l’étalage d’argent perdu au pharaon ou au biribi, inspirant un vertige comparable à celui que peuvent donner les bénéfices engrangés par certaines sociétés ou les parachutes dorés de certains privilégiés. Pour apprécier l’hostilité grandissante qui se développe à l’égard des Grands, rien ne vaut peut-être la lecture de la correspondance de Mercy-Argenteau. Il n’est pas tendre envers ce comte d’Artois, frère du roi et futur Charles X, à qui le prince de Ligne, après « une tournée charmante » qu’ils firent « à Rocroy, à Spa, etc. », offre une grande fête, du type de celles qui lui « coûtèrent plus de cinquante ou de soixante mille francs ». L’épisode est raconté dans les Fragments de l’histoire de ma vie publiés par Raymond Trousson et par Jeroom Vercruyssse (6e cahier)[48]. Le prince rapporte ailleurs comment le comte d’Artois décida de l’entraîner avec lui à la chasse au sanglier dans la forêt de Fontainebleau. Les Hennuyers furent-ils plus bienveillants que les Parisiens ? Voici en tout cas ce que ce genre de divertissement inspira aux seconds, d’après Mercy-Argenteau[49] : «M. le comte d’Artois, qui ne s’occupe que de frivolités, a imaginé de venir souvent chasser le daim dans le bois de Boulogne. La proximité de Paris attire à ces chasses un nombre de jeunes gens, hommes et femmes. Le prince, après la chasse, donne à dîner dans de petites maisons de campagne situées dans ce même bois de Boulogne. Ces dîners, sans donner lieu absolument à des indécences, sont cependant beaucoup trop gais. La reine n’a pu résister aux sollicitations pressantes que lui a faites M. le Comte d’Artois de venir à ces chasses, qui ne sont que des promenades. Quoique, comme de raison, Sa Majesté ne soit jamais restée à aucun des dîners qui terminent les chasses, cependant on a vu à Paris avec regret que la reine s’associât aux parties de plaisir de M. le Comte d’Artois, qui, par sa légèreté, perd de plus en plus dans l’opinion publique. »
Le prince de Ligne nous garantit à plusieurs reprises le contentement que suscita son administration et évoque les sentiments unanimes que lui portent ses sujets. « Je n’ai jamais fait de mal à personne ». Sa bonacité — trait, paraît-il, typiquement wallon… — lui tient lieu de doute. R. Mortier a rappelé récemment la note discordante qu’apporte le libelle d’un certain Masson, « espèce d’avocat de Nivelles », dans un libelle qui traite Ligne de « Jean-foutre » et dit qu’à son « entrée de gouverneur du Hainaut », le prince « avait l’air d’un vieux Priape, entouré de filles dont il s’occupait uniquement[50] ». L’affaire le préoccupe-t-elle ? Il en répète la relation, presque identique, dans les Fragments et dans les Mémoires[51]. De cela aussi, il faudra bien tenir compte quand le moment sera venu de célébrer le deux-centième anniversaire de la mort du maître de Beloeil. De cela aussi, il faudra bien tenir compte quand le moment sera venu de célébrer le deux-centième anniversaire de la mort du maître de Beloeil.
Ceux et celles qui prirent la plume au 18e siècle pour évoquer leur séjour à Spa présentent volontiers le « café de l’Europe » comme le merveilleux spectacle dû à une « lanterne magique », ainsi que l’écrit Madame de Krüdener[52]. Mais le « vertige universel » qui « faisait danser, jouer, monter à cheval tout ce qui avait des jambes, de l’argent » favorisait l’illusion. Car le « laboratoire de liberté» que semblent dessiner certaines expériences n’est-il pas plutôt l’espace clôturé d’un repli ? Spa, « île des doux secrets et des fêtes du cœur », a déjà quelque chose du « pendu déjà mûr » que découvre Baudelaire, après Nerval, dans le Voyage à Cythère. L’univers du prince de Ligne est, dans sa fermeture à certaines réalités contemporaines, remarquablement évocateur de cette insularité. Spa, par une concentration exceptionnelle des désordres et des déclins, des liaisons dangereuses et des provocations cyniques, n’offrait-il pas surtout l’image d’un régime finissant, proche d’une toute naturelle implosion ?
NOTES

[1] Strasbourg : Trettel ; Paris, Onfroy, 1789, p. 188, 201-205.
[2] P. 252. Le passage fait défaut dans : Le destin extraordinaire du baron de Trenck. Mémoires. Texte présenté et annoté par R. Bolster, Paris : Pygmalion, 1986.
[3] P. 185.
[4] 9 septembre 1767.
[5] Elle me coûte dix mille écus. La contrefaçon des œuvres de Molière offerte par l'imprimeur Bassompierre à Marmontel », Revue française d'histoire du livre 114-115, 2002, p. 125-164.
[6] 30 mai 1768, à la Boule d’Or, Voir S. Dagenais, « Henry Ellis à Spa: vie mondaine, rumeurs et nouvelles au temps de la guerre d'Indépendance américaine », Colloque Spa, carrefour de l’Europe des Lumières. Les hôtes de la cité thermale au 18e siècle. Organisé par la Société wallonne d’étude du 18e siècle, Centre culturel de Spa, Salon bleu, 25-26 septembre 2012.
[7] 1er septembre 1769, à l’Éléphant.
[8] Ma vie. Édition établie par M. Orcel, Paris : Éd. G. Lebovici, 1989, p. 96 sv.
[9] « Le premier amour d’Alfieri », Mercure de France I/VIII, 1947, p. 631-643.
[10] 2 août 1768.
[11] H. Hasquin (dir.), L’Académie impériale et royale de Bruxelles : ses académiciens et leurs réseaux intellectuels au XVIIIe siècle, Bruxelles : Académie royale de Belgique, 2009, p. 205. Communication M. Collart.
[12] Valenciennes : Au Bureau des Archives, 1834, p. 111-113.
[13] Notice « Chasteler », Biographie nationale de Belgique, t. IV, 1873, col. 25-31. H. Hasquin (dir.), L’Académie impériale et royale de Bruxelles : ses académiciens et leurs réseaux intellectuels au XVIIIe siècle, Bruxelles : Académie royale de Belgique, 2009, p. 205.
http://gw5.geneanet.org/wailly?lang=en&p=catherine+elisabeth&n=van+hasselaer.
[14] P. 116.
[15] « La vie d’Alfieri », Le temps, 25 février 1936.
[16] Duel dont Body fait état dans le Supplément manuscrit à la Liste des Seigneurs et Dames (http://www.swedhs.org/visiteurs/supplements/1770.pdf.). Cf. M.-C. Schils et J. Toussaint, Livre d’or de Spa. Editions du Musée de la Ville d’eaux, 2006, p. 42.
[17] 8 septembre 1770.
[18] P. 287-288.
[19] 8 septembre 1770.
[20] 15 juillet 1770, hôtel de l’État noble.
[21] C’est donc, en quelque sorte, un voyage préliminaire — un essai de partenariat — que constitue le séjour à Spa. Fragonard aura pour mission d’effectuer, chemin faisant vers l’Italie, des croquis qui appartiendront à son protecteur, en manière de rétribution. Le document consignant le voyage en Italie est conservé. Il a été édité en 1895. Mais l’édition n’est précédée d’aucune relation concernant Spa, ce qui est bien regrettable.
[22] 6 juin 1774.
[23] Correspondance privée de Frédéric-Melchior Grimm : 1723-1807. Présentée et annotée par J. Schlobach et V. Otto, avec la collaboration de Jean de Booy, Genève : Slatkine, 2009, n° 273, 21 sept. 1782, p. 361. Voir M. Molander Beyer, « Gustave III et les Suédois à Spa », Colloque Spa, carrefour de l’Europe des Lumières. Les hôtes de la cité thermale au 18e siècle. Organisé par la Société wallonne d’étude du 18e siècle, Centre culturel de Spa, Salon bleu, 25-26 septembre 2012.
[24] Diderot, Œuvres. Tome III. Politique. Edition établie par L. Versini. Paris : Laffont, 1995, p. 763-764.
[25] P. 232.
[26] 19 juillet 1783. Mémoires, 2e éd., Paris : Ladvocat, 1822, t. I, chap. XIV, pp. 274 sv. Lord Shelburne est accompagné de Lady Louisa, née FitzPatrick (1755-1789), des demi-sœurs de celle-ci, Louisa, Henrietta et Caroline Maria Vernon, et de John Henry, fils d’un premier mariage, né en 1765.
[27] Mémoires. Préface de M. Delon, Paris : Nouveau monde, 2006.
[28] Neuchâtel : A la Baconnière, 1976, p. 416.
[29] « Un amour platonique au XVIIIe siècle. Madame de Coigny et Lauzun ». Revue des deux mondes 95, 1889, p. 568-570.
[30] Pour Amélie de Boufflers, à Spa en 1780, cf. Livre d’or de Spa, p. 47 ; pour Louise-Marie de Conflans, marquise de Coigny, à Spa la même année, ibid.,, p. 44.
[31] Aristocrats. Caroline, Emily, Louis, and Sarah Lennox 1740-1832, New York: Farrar, Straus and Giroux paperback ed., 1995, p. 128 sv.
[32] Mémoires du duc de Lauzun (1747-1783). Seconde édition par L. Lacour, Paris : Poulet-Malassis et de Broise, 1858, p. 54, 57.
[33] Ibid., p. 63.
[34] Ibid., p. 67-69.
[35] 4 juillet 1767.
[36] http://www.youtube.com/watch?v=WeHguzlLHyw&feature=relmfu
[37] Respectivement : 16 juillet 1773. Madame Michèle Galand m’a aimablement communiqué des informations montrant que Louis Pierre Legendre, né à Paris en 1730 ou 1732, avait effectivement été attaché à la cour de Bruxelles à partir de 1764 (S. Anciaux et S. Lavelleye, « Notes sur les peintres de la cours de Charles de Lorraine », Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art 3, 1936, p. 317-320. Courriel de M. Galand du 25/11/2012). Quatre ans plus tard, il épouse à Sainte-Gudule « une jeune personne de cette ville, née d’honnêtes parents sans opulence, mais d’un excellent caractère et vertueuse », Pétronille Marielle, qui meurt en 1772. C’est donc un homme frappé d’un veuvage encore récent qui prend le chemin de la ville d’eaux à l’été suivant. Un document autobiographique fait par ailleurs état des difficultés qu’il rencontra dans sa charge, quand ses occupations au service de son Altesse royale « diminuèrent » au point que Legendre « reprit son projet d’aller se mettre en état d’être reçu à l’Académie de France », ce qui provoqua le « mécontentement » de Charles de Lorraine. La présence de l’artiste à Spa participait-elle d’un essai récurrent pour étendre son marché ?
L’hôtel du Prince Ferdinand de Prusse portait le n° 15 de la rue des Capucins et s’élevait à l’endroit où se trouve aujourd’hui le Funerarium Vilvorder.
[38] 26 juillet 1773. L’activité de Ketterlin, Son activité, m’écrit Madame Nathalie Lemoine-Bouchard, auteur du Dictionnaire des peintres en miniature actifs en France (2008), paraît attestée dès 1765 par une œuvre conservée au Victoria et Albert Museum de Londres (Courriel du 2 juin 2012). Pour la miniature de 1765 : V&A, inv. P27-1924. La production de l’artiste paraît pour le reste s’échelonner de 1780 à 1792, mais l’omission du prénom ou des initiales en rend l’identification difficile Il ne peut s’agir de Louis Ketterlin, Français ou Suisse actif à Londres, .si la date de naissance indiquée par Thieme et Becker (1770) est correcte. « Un JJ Ketterlin, peintre en miniature mort à Bâle en 1813, pourrait avoir été actif en 1773 mais on ignore tout de lui ».
[39] A. Mikhailov, notice « Gallien de Salmorenc » dans le Dictionnaire des journalistes 1660-1789. 2e éd.. Oxford : Voltaire Foundation. 1999, 326. – Éd. électronique revue, corrigée et augmentée. http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/dictionnaires-presse-classique-mise-en-ligne.
[40] Pour la vignette gravée décorant la p. de titre, voir la base de données typographiques du « Nouveau Môriâne » sur le site de la Société wallonne d’étude du 18e siècle, ornements 415 et 473 - http://www.swedhs.org/moriane/index.html
[41] 1er juillet 1777, à l’hôtel Impérial.
[42] P. Peyronnet, article « Rutlidg » dans le dans le Dictionnaire des journalistes 1660-1789. 2e éd.. Oxford : Voltaire Foundation. 1999, 722. – Ed. électronique revue, corrigée et augmentée. http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/dictionnaires-presse-classique-mise-en-ligne. n° 722.
[43] Paris : H. Champion, 2007.
[44] Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte de Mercy-Argenteau, Publiée avec une introduction et des notes par A. d’Arneth et M.A. Geffroy, Paris : Didot, 1874, lettre XXVII, p. 56.
[45] 24 juillet 1782.
[46] Mémoires, p. 213-218.
[47] Née en 1757, Georgiana Spencer était à Spa en 1764, 1767, 1770, 1772 et 1773. Le séjour s’arrête en 1774 quand elle épouse William Cavendish.
[48] Lettres et pensées : d’après l’édition de Madame de Staël ; suivi de Fragments de l’histoire de ma vie. Introd. et notes, chronologie et bibliogr. par R. Trousson. Paris : Tallandier. 1989, p. 311-312 ; Fragments de l’histoire de ma vie. Établissement du texte, introduction et notes par J. Vercruysse. Paris : Champion. 2008 (Champion Classiques), p. 101.
[49] T. III, p. 94 (lettre III du 19 janvier 1774), p. 332 (lettre XXIV du 18 mai 1775) et p. 355 (lettre XXXII du 17 juillet 1775).
[50] « Un mentor du prince de Ligne : le Père Henri Griffet (1698-1771). Nouvelles annales prince de Ligne 17. Bruxelles : Groupe d’Études Lignistes. 2008, p. 29-46.
[51] Fragments, éd. Vercruysse, p. 134 ; Mémoires. Préface de Ch. Thomas, Paris : Mercure de France, 2004, p. 179-180.
[52] Voir E. Gretchenaia et C. Viollet, « Voyageuses russes à Spa », Colloque Spa, carrefour de l’Europe des Lumières. Les hôtes de la cité thermale au 18e siècle. Organisé par la Société wallonne d’étude du 18e siècle, Centre culturel de Spa, Salon bleu, 25-26 septembre 2012. E. Gretchenaia y précise : « Il est probable que ce texte ait été rédigé après que Mme de Krüdener, après maintes pérégrinations à travers l’Europe, se soit installée dans son domaine à Kosse, en Livonie, ce qui eut lieu en mai 1818. Quelques fragments de ces souvenirs ont été publiés par Francis Ley dans ses ouvrages, d’après une copie établie par une des petites-filles de la baronne ; l’original n’a été publié par mes soins qu’en traduction russe. » | |



|






















