

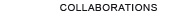


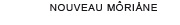


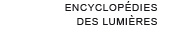
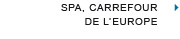
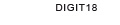
|
|
Visiteurs à Spa > L'Avant-Coureur spadois
N° 8. Quand la peinture
liégeoise se
donnait à voir
aux hôtes de Spa, à Fragonard
et à tel autre voyageur

Par DANIEL DROIXHE
Le 27 août 1781, la comtesse de Sabran écrivait de Spa :
Aujourd’hui je suis beaucoup mieux, et si bien que j’espère être en état d’accompagner notre bon prince à Aix-la-Chapelle, où il veut absolument me donner à souper, et delà j’irai jusqu’à Düsseldorf. J’espère que j’aurai assez de force pour exécuter tous ces projets. Mme de Cambis ne sera pas de la partie : le duc de Richmond est un peu incommodé, et, d’ailleurs, il est au moment de son départ[1].
Madame de Sabran se trouvait alors à Spa pour soigner une santé qui apparaît fragile de longue date[2]. Cette jeune veuve, qui avait épousé en 1769 un homme plus âgé qu’elle de près d’une cinquantaine d’années, décédé en 1775, tâchait alors de surmonter un mélange de « langueur » et de maux variés dans diverses retraites curatives ou stations à la mode : à Anizy-le-Château, dans l’Aisne, à Ermenonville, sur les traces de Rousseau, en Suisse, à Voré, à Aix-la-Chapelle et à Spa. Elle écrivait le 21 juin 1781 au chevalier de Boufflers, avec lequel elle entretenait alors une récente relation amoureuse, que, souffrant « horriblement de la tête, de la poitrine, du foie, de la rate, etc. », elle avait eu le projet de se rendre au plus tôt à Anizy[3] : « mais Tronchin n’a pas voulu à cause de certaines raisons qui exigent des ménagements ». Le célèbre médecin de Voltaire avait son idée sur le remède le plus indiqué.
Dans l’état de faiblesse où je suis, il croit toujours que les eaux de Spa me sont nécessaires ; et moi, je ne doute pas qu’elles ne me guérissent. Vous savez combien je crois aux pressentiments, et j’ai celui-là. D’ailleurs, je tempérerai la force de ces eaux en les coupant avec de l’eau de veau ou du lait ; et quand ce ne serait que le changement d’air, le voyage et la dissipation, je m’en trouverais encore bien. Ainsi je suis déterminée à faire ce voyage, et je compte partir le 10 d’août.
Madame de Sabran précipita les choses, car elle fut inscrite le 1er août sur la Liste des seigneurs et dames venus aux eaux minérales de Spa, l’an 1781 — le document imprimé où les hôtes de la cité se trouvaient invités à signaler leur arrivée et leur logement, afin de faciliter les contacts. Elle s’installa au Duc de Bavière, rue de l’Assemblée, c’est-à-dire dans l’actuelle rue Royale, une des artères les plus dévastées, par l’incendie de 1807 et par l’urbanisme prétentieux des 19e et 20e siècles. Elle y effectuera des séjours annuels jusqu’en 1785.
Celui de 1781 est donc marqué par l’excursion à Düsseldorf. Ceux qui y participent sont apparemment emmenés par « notre bon prince », c’est-à-dire Henri de Prusse, frère de Frédéric II, descendu sous le pseudonyme de « Comte de Öels » le 10 juillet à l’hôtel du Lion noir, sur la Grand-Place. On a vu par la lettre du 27 août que Madame de Cambis et son caduc ami le duc de Richmond, inscrits depuis le début du mois dans des établissements de la Promenade de Sept Heures (celui du duc se trouvait à peu à l’emplacement de l’actuel hôtel Radisson), firent défaut. Le groupe devait par ailleurs comporter, ajoute la lettre: « milord du Moley, un Anglais et un Russe de fort bonne compagnie». Faut-il identifier le premier avec un « Monsieur Lecouteulx du Moley », peut-être Jacques-Jean Le Couteulx du Molay ou Moley, qui arrive à Spa le 24 juillet ? Ce dernier, qu’on qualifie de « Trésorier de la Caisse d’Extraordinaire », évoluait dans un contexte rouennais et on ne voit pas en quoi serait justifié le titre de « milord ». La référence à « un Anglais », ici en apposition, désignerait un curiste non identifié.
Par contre, on enregistre le 12 août l’arrivée d’un groupe important de personnalités russes, groupées autour du prince et de la princesse Gagarin, qui occupent les hôtels du Prince de Galles et du Dragon d’or, sur la Grand-Place, ainsi que celui de l’Orange, rue de l’Assemblée. A. Stroev a bien voulu examiner avec laquelle conviendrait le mieux la mention du « Russe de fort bonne compagnie ». Il pourrait s’agir d’Alexandre Lvovitch Narychkine (1760-1826), au sujet duquel les rapports de la police parisienne écrivent le 7 décembre 1781 qu’il « a passé la saison des eaux à Spa » et que, « depuis ce temps il a parcouru une partie de l’Allemagne[4] ». « Monsieur Narischkine, Gentilhomme de Chambre, et Brigadier de S.M. l’Impératrice de toutes les Russies », fait en effet partie du groupe évoqué plus haut. Il venait d’être nommé, en 1778, « gentilhomme de Chambre » et occupera par la suite les fonctions de chambellan (1785), de grand maréchal de la Cour (1798), de directeur des Théâtres impériaux (1799-1819). Ce franc-maçon offre bien l’image, en 1781, d’un jeune homme prometteur, intéressé par les arts, comme il convient à ceux qui vont faire le voyage d’Allemagne. On eût aimé disposer d’une relation de son séjour.
Le voyage à Düsseldorf devait prendre « cinq ou six jours ». De retour à Spa, Madame de Sabran, après le récit de démonstrations très affectueuses de la part de « mon prince », écrivait le 1er septembre à Boufflers : « J’ai vu à Düsseldorf beaucoup de chefs-d’œuvre fort au-dessus des tiens en dessin et en peintures. À peine ai-je eu le temps de tout voir[5]… » La référence est évidente : les touristes ont visité la célèbre collection d’œuvres d’art rassemblée d’abord par Johann Wilhelm II von der Pfalz, prince-électeur du Palatinat (1658-1716). L’histoire en est racontée par Thomas W. Gaehtgens et Louis Marchesano, que l’on suit ici[6].
La collection nous est principalement connue par l’inventaire détaillé dû à Nicolas de Pigage et Christian von Mechel, qui parut en 1778 — ouvrage peut-être utilisé par les excursionnistes. Celui-ci est parfois mis au nom de l’architecte lorrain Nicolas de Pigage (1723-1796) en raison du titre indiquant qu’il l’a « composé dans un goût nouveau ». On tend aussi à l’imputer à l’éditeur bâlois auteur de l’impression et des 365 petites estampes qui, « rédigées et gravées d’après ces mêmes tableaux », distribuées en trente planches, enrichissent l’in-folio en deux volumes : c’est-à-dire le Suisse Christian von Mechel (illustration 1).

Illustration 1
Johann Wilhelm II avait fait construire, de 1709 à 1714, un bâtiment destiné à abriter sa collection, qui était adjacent à son palais de Düsseldorf. Il s’agissait donc d’un espace réservé à la présentation des œuvres, même si l’on y communiquait par un coin du palais. Le bâtiment que parcoururent les amateurs spadois de la seconde moitié du siècle se présentait en forme de U et comportait deux étages (illustration 2).

Illustration 2
Plan du premier niveau de la Galerie Électorale.
Planche de l’ouvrage Pigage-Mechel de 1778.

Illustration 3
La Galerie Electorale de Düsseldorf.
Planche de l’ouvrage Pigage-Mechel de 1778.
Un premier catalogue imprimé de la Galerie avait été réalisé par un intendant de celle-ci, Gerhradt Joseph Karsch. Dépourvu de tout commentaire, l’ouvrage montrait « que les diverses écoles de peinture était encore mélangées » et que les œuvres « se trouvaient accrochées selon des considérations purement décoratives », ainsi que l’écrit Thomas W. Gaehtgens dans la première partie de l’ouvrage publié avec L. Marchesano, intitulée Making an Illustrated Catalogue in the Enlightenment[7]. Ainsi, les trois premières salles étaient vouées aux peintres flamands et italiens ainsi qu’à des peintures contemporaines (voir le plan). La salle du milieu conservait les œuvres de l’artiste considéré par l’Électeur comme le plus important, c’es-à-dire Rubens, tandis que les deux autres accueillaient les écoles flamandes et italiennes « sans système d’organisation thématique ».
On peut seulement supposer que certains critères artistiques tels que la composition, le dessin et la couleur déterminaient l’arrangement choisi par Karsch. Les impressions de Montesquieu, enregistrées lors de sa visite à Düsseldorf en 1729, témoignent de l’admiration du visiteur français, mais ne donnent malheureusement aucune information supplémentaire en ce qui concerne la logique d’organisation de la collection.
Celle-ci fut l’objet des attentions du successeur de l’Électeur Carl Theodor (1724-1787), qui se préoccupa de l’étendre et d’en promouvoir la fréquentation. Après qu’elle ait subi quelques modifications au milieu du 18e siècle, un nouveau directeur de la Galerie, Lambert Krahe dut la mettre en caisse et l’entreposer temporairement à Mannheim pour la soustraire aux vicissitudes de la guerre de Sept Ans (1756-1763). La réinstallation à Düsseldorf, dès 1762, donna lieu à un accrochage tout différent. La production italienne, désormais considérée comme plus importante, prit la place des œuvres de Rubens dans la salle centrale de la Galerie. C’est l’organisation spatiale que décrivit l’ouvrage de Pigage et Mechel de 1778, et
que découvrirent Madame de Sabran et ceux qui l’accompagnaient en 1781.
Par les changements qu’opéra Krahe, la galerie consacra une nouvelle conception de présentation. Son arrangement se fondait sur les différentes écoles de peinture, dont la cohésion était soulignée. Les œuvres des Flamands, des Italiens et de Rubens, le plus important peintre-génie du Nord, se voyaient attribuer les grandes salles. Dans les salles plus petites qui formaient les coins de la construction était logé un mélange d’illustrations de différentes écoles, pour créer des transitions d’une école à une autre.
On comprend que cet ordonnancement peut conférer une certaine signification à l’accrochage des œuvres liégeoises dont il va être question. Celles-ci trouvaient évidemment leur place dans cet ensemble en tant que production appartenant à l’école flamande. Comme le note Gaehtgens.
Un panorama de l’histoire de la peinture ne pouvait être atteint dans la Galerie de Düsseldorf. L’Électeur ne s’était pas intéressé à la peinture allemande, française, espagnole ou anglaise. C’est seulement à la fin des années 1770 que la collection de l’empereur d’Autriche à Vienne, d’une beaucoup plus grande ampleur, rendrait possible un tel arrangement, à l’étage supérieur du musée de l’Electeur.
Concernant l’approche des œuvres par le visiteur, on notera d’abord que la disposition adoptée par Krahe les distribuait en laissant entre elles un certain espace, parce qu’elle en accrochait moins, par salle, que dans la très accumulative présentation de Karsch, qui proposait davantage d’œuvres. Ainsi, dans la première salle, Krahe en réduisit le nombre, qui passa de 80 peintures à 50. Le visiteur était ainsi invité à considérer plutôt les « qualités individuelles de chaque œuvre ». Pour le reste, la mise en valeur des peintures suivait une logique assez naturelle : celles illustrant une école déterminée étaient disposées symétriquement autour d’une grande œuvre centrale « pour inspirer au visiteur l’impression totale de la richesse et de la diversité de l’école en question ». En raison de leur longueur, les murs des salles 1, à droite, 2, à gauche, et 3, précédée de l’Avant-Corps (voir l’illustration 2) se divisaient en trois parties. L’étude de Gaehtgens reproduit l’occupation de la « Première Salle », avec la « 1ère Salle », au « Milieu de la IIde Façade », la « Partie à droite de la Seconde Façade » et la « Partie à gauche ». En dehors d’une organisation de l’espace en fonction des dimensions des œuvres, celles-ci étaient groupées avec une certaine « cohérence thématique » qui faisait se répondre portraits, natures mortes, etc. Mais la galerie offrait surtout une peinture historico-religieuse qui, très conforme aux conceptions et centres d’intérêt d’un propriétaire relevant de l’Église, bousculait quelque peu cette cohérence…
Il s’agit maintenant de concentrer les regards sur la peinture liégeoise, objet d’un article qui devrait être complété par une étude en règle. Plusieurs artistes nés dans la principauté, parmi les plus notables, étaient présents à Düsseldorf. Il y aurait à considérer la signification éventuellement accordée à leur distribution dans l’espace muséal, en fonction de ce qui vient d’être dit, mais aussi et d’abord leur poids relatif par rapport à l’ensemble des œuvres présentées. Il va de soi que l’école dite « proprement flamande » écrase ce qui pourrait s’appeler « l’école liégeoise » — si le lieu de naissance détermine l’appartenance à une école ou à un espace géographique, et non le lieu où se construit, s’exerce, se marchande le talent de tel artiste. Le droit du sol conçu de manière strictement « bio-génétique » s’oppose ici, de manière particulièrement délicate dans le cas des artistes wallons, à l’argument voltairien voulant que « le bonheur est où je suis ». À partir de quel moment l’existence même d’un individu et l’affirmation de celui-ci, éventuellement à travers un talent, ne sont-elles pas davantage liées aux conditions locales d’un développement, plus qu’à « l’origine » ?
Inutile d’insister sur la place qu’occupe ici « l’école flamande ». À propos de la « Cinquième salle dite de Rubens », le catalogue annonce :
Cette salle contient une suite de quarante-six Tableaux de Pierre Paul Rubens la plûpart des plus beaux de ce grand peintre ; cette suite précieuse fait une des principales richesses de cette Galerie et contribue le plus à sa renommée.
La quatrième salle exposait une dizaine de Rembrandt.

Illustration 4
La « Seconde façade » de cette « Quatrième salle » présentait notamment La descente de Croix et L’élévation de la Croix de Rembrandt,
conservées aujourd’hui à l’Alte Pinakothek de Munich.
Les pièces se trouvent de part et d’autre
de l’Assomption de la Vierge de Guido Reni[8]
On laissera de côté ce dont il est question dans l’étude de Gaehtgens sous les intitulés suivants : Pigage and Mechel’s Catalogue, The Preparatory Drawings at the Getty Research Institute, From Drawings to Prints, Reception and Criticism of the Engravings[9]. Par contre, l’identité du rédacteur des notices consacrées à chaque pièce intéresse l’appréciation des œuvres liégeoises (Who Was the Author of the Text[10]).
On considère généralement que Pigage est l’auteur des textes du catalogue parce qu’il à signé l’introduction. Ceci, cependant, est hautement invraisemblable, dans la mesure où une connaissance aussi précise de la peinture et le traitement des pièces particulières peuvent difficilement être imputés à un architecte par ailleurs très occupé. Quoiqu’on n’en possède aucune preuve documentaire directe, il existe suffisamment d’indicateurs tendant considérer que le texte résulte d’un effort de collaboration. Si Mechel a dû jouer un rôle majeur dans la détermination du contenu, il a probablement délégué le travail d’écriture et d’édition. Il y a une bonne raison d’identifier l’auteur effectif du texte avec Jean-Charles Laveaux (1749-1827).
Originaire de Troyes, Laveaux s’était installé en 1776 à Bâle pour y enseigner le français : il se fera connaître au début du 19e siècle comme linguiste, auteur d’un Dictionnaire raisonné des difficultés grammaticales et littéraires de la langue française (1818, 1822, 1846, 1873, etc.). En la matière, il se signale aussi par la révision d’un Dictionnaire français-allemand et allemand-français dont la deuxième édition parut en 1784-1785. Une connaissance précoce de la langue germanique peut rendre compte, comme le suggère Gaehtgens, du fait qu’il s’occupa peut-être simplement de la traduction des notices de l’allemand en français[11]. Il ne semble pas qu’il possédait des compétences particulières dans le domaine des arts, et « une lecture attentive du catalogue de Dûsseldorf permet de suivre à la trace certaines des sources érudites qui furent utilisées ». On passera également sous silence celles dont traitent les chapitre sur Laveaux’s Art-Historical Sources, Laveaux’s Visites to Düsseldorf, Krahe’s Display, etc. qui nous éloigneraient de notre propos, pour en venir aux tableaux liégeois dont a choisi de traiter ici[12].
Parmi ces artistes figure d’abord Gérard Douffet. Ce que l’on considère généralement comme deux de ses trois œuvres majeures étaient présentées au visiteur. On sait dans quelles circonstances — jugées déplorables ou bénéfiques, selon les avis — furent transférées en Allemagne dès la fin du XVIIe siècle : L’invention de la sainte Croix et La visite du pape Nicolas V au tombeau de saint François d’Assise[13].
La première œuvre connut un destin dont fait état le « catalogue électoral » — à l’origine d’un parcours qui devait l’intégrer aux collections du château de Schleissheim (près de Münich) où elle se trouve aujourd’hui. Le catalogue cite « un manuscrit, qui est entre les mains de la famille Douffet », où « on lit l’anecdote suivante », bien connue :
Ce Tableau est un monument de la piété de Dom Charles Hardi, Religieux de l’Abbaye de Saint Laurent à Liége ; il est peint avec tant d’art et d’un si grand goût, qu’il n’offre rien qui ne soit un objet d’admiration, et rien ne prouve mieux le prix de ce morceau, que l’empressement avec lequel, il a été recherché par l’Electeur Jean Guillaume (qui en paya le double de ce qu’on en avoit demandé) pour le placer parmi le grand nombre d’excellents Tableaux, qu’il avait rassemblé à Dusseldorff, des plus habiles Maîtres d’Italie et des Pays-Bas, où cette pièce tient un rang honorable.
Le tableau, de grandes dimensions — « haut de 9 pieds 8 pouces ; large de 11 pieds 4 pouces » —, se trouvait en principe exposé sur la « Troisième Façade » de la « Première Salle », où il porte le n° 39. Il n’a pas été possible de le présenter lors de la grande exposition sur Le siècle de Louis XIV au pays de Liège, qui s’est tenue au Musée de l’Art wallon en 1975, alors que le château de Schleissheim a fourni un Portrait d’homme à la barbe rousse, contemporain de l’Invention (catalogue, n° 295). Il est regrettable qu’on ne puisse en présenter ici une reproduction à partir d’Internet.
Ce n’est pas ici l’endroit de rappeler en détail le sujet ou les caractères de l’Invention de la Sainte-Croix de Douffet, œuvre dont on a mis en évidence l’utilisation du clair-obscur pour structurer « un grand nombre de figurants qui », sans cela, « seraient surabondants » (J. Hendrick). La notice du catalogue de la Galerie Électorale y ajoute un premier élément dynamique de construction : celui-ci réside dans l’homme qui se trouve « en avant à gauche », « avec un habillement rouge, portant un grand livre fermé ». Le personnage « est tellement frappé de l’évènement, que, saisi d’une frayeur subite, il s’éloigne avec précipitation ». « Cet homme fait un beau contraste dans le Tableau, où presque tous les autres spectateurs semblent immobiles d’étonnement. » « Le groupe des trois hommes qui soutiennent la Croix derrière le ressuscité, contribue aussi à donner le mouvement nécessaire à cette belle composition. »
Pour Pierre-Yves Kairis, cette toile constitue « le véritable tableau manifeste de l’école liégeois du 17e siècle » : « Le peintre introduit à Liège les conceptions caravagesques alors à la mode dans la péninsule. Curieusement, cette toile apparaît plus proche de la manière de Simon Vouet que de celle des manfrédiens. Et nous sommes bien loin du baroque rubénien ». La distance prise avec Rubens, chez lequel Douffet aurait travaillé deux ans, est soulignée par la plupart des critiques et sa peinture, en tête de l’école liégeoise, est autant « fille de Paris que de Rome », pour paraphraser l’expression employée autrefois par Joseph Philippe[14]. On notera que la « troisième façade » sur laquelle est accrochée la toile ne comporte aucune œuvre du maître d’Anvers, dont la production se trouve, il est vrai, rassemblée dans la « Cinquième salle dite de Rubens ». On laisse aux spécialistes le soin d’apprécier dans quelle mesure l’œuvre de Douffet et la production liégeoise s’opposent « en thèse générale », comme disait aussi J. Philippe, au « rubénisme des maîtres flamands » en proportion du « poussinisme » qu’on décèle chez les peintres des bords de Meuse.
L’examen auquel le « catalogue électoral » soumet l’Invention de la Croix est quant à lui beaucoup plus sensible à ce que J. Hendrick qualifiait de « caractère » ou de traduction « intense » des sentiments par « l’attitude » ou « l’expression du visage ». On songerait volontiers ici à l’écho de l’attrait qu’éprouvent les Lumières pour les manifestations extrêmes de l’émotion, aux limites de l’horreur ou du terrible, ainsi que les définissent le Sturm und Drang ou Marmontel dans l’article « Enthousiasme » de l’Encyclopédie méthodique — on n’en est pas loin avec Pigage et Mechel. Ainsi, le cadavre qui ressuscite au contact de la vraie croix, selon l’épreuve imaginée par l’impératrice Hélène, est montré « sur son séant », « enveloppé en partie dans son linceul », la peau « encore pâle et livide », avec une « expression [qui] est le vif étonnement d’un mort rendu subitement à la vie ».
Les femmes, les soldats et le peuple qui l’environnent, paroissent également saisis d’étonnement et d’admiration. Une femme à genoux derriere le ressuscité, qu’elle soutient d’un bras, le regarde avec une attention mêlée d’effroi : elle paroit lui appartenir par l’intérêt et l’empressement qu’elle montre ; elle couvre une partie de son visage avec un linge, pour se préserver de la puanteur du cadavre, qui vient d’être rendu à la vie. Trois femmes à genoux, près du cheval de Sainte Hélène, également saisies d’étonnement et d’effroi, forment un groupe très-intéressant et plein d’expression.
J. Hendrick détache aussi « l’étonnement » qu’ « un vieillard traduit intensément », à gauche, tandis que « l’homme qui se bouche le nez accentue le vérisme de l’œuvre » : à quoi s’accorde chez Douffet un « modelé vigoureux caractéristique » qui « témoigne une fois encore de la formation naturaliste du peintre » (P.-Y. Kairis). Le catalogue de 1778 conclut : « Ce Tableau est en général très-recommandable pour la composition, le dessin, la touche hardie et la force d’expression : il seroit parfait dans toutes les parties, si celle du coloris étoit portée au même degré. » J. Hendrick se bornera à noter que « le coloris est à dominante de bruns foncés sur lesquels tranchent fortement des tons rouges, orangés, blancs grisâtres ». « Réalisme », « naturalisme » et cette « force d’expression » que P.-Y. Kairis ne reconnaît plus dans les œuvres de la fin de vie de Douffet.
Le même historien rappelle que l’artiste fut nommé en 1634 peintre officiel du prince-évêque de Liège Ferdinand de Bavière », qu’il avait alors atteint « le sommet de sa gloire », mais qu’il « ne tardera pas à sombrer dans le déclin ». En 1636, au plus fort de la guerre civile entre les « Chiroux », les Liégeois à l’habit en queue-de-pie, dévoués au prince et à l’aristocratie, et les « Grignoux », les grincheux de la petite bourgeoise et du peuple, Douffet fera le portrait du leader des seconds, Sébastien La Ruelle (n° 298 du catalogue de l’exposition de 1979). En 1637, l’assassinat du meneur marquera leur défaite. Le portrait du héros, que l’artiste peint sur son lit de mort, sonne comme le glas d’un espoir de changement de société. Difficile de ne pas mettre cette rupture en rapport avec « l’affadissement » que l’on enregistre dans sa peinture, quand Douffet ne retrouve pas quelque chose de sa verdeur d’autrefois, comme dans L’adoration des bergers des Vieux Joncs (Alden Biesen, vers 1640).
On ne s’attachera pas ici à la manière dont est commenté en 1778 le second grand tableau de Douffet acheté aux Liégeois. La célèbre Visite du pape Nicolas V au tombeau de saint François d’Assise a terminé sa carrière à l’Ancienne Pinacothèque de Munich, où elle fut, comme les autres œuvres de la Galerie Électorale, transférées après la paix de Pressbourg en 1805. Le catalogue (n° 65) le trouvait « d’une grande composition, et d’un effet imposant », notamment en raison de la présence d’un « magnifique porche d’architecture » : ce dernier trait s’invitera parmi les caractères majeurs du style liégeois quand il sera question, ci-dessous, de Gérard de Lairesse. Quant aux deux Portraits d’homme que possédait la Galerie Palatine, ils prenaient place, sur la « première façade » de la « quatrième salle » après un Ribera (Le roi Manassès en captivité, n° 195) et un Velasquez (Portrait d’homme, n° 196 ; voir illustration 6). C’est tout dire. Le Portrait d’homme à la barbe rousse, qui date de la même année que l’Invention de la Sainte Croix, est supposé représenter « un ancien Magistrat de Liége ». Egalement conservé au château de Schleissheim, où il est exposé, note J. Hendrick, « entre deux toiles de Rubens », il fut prêté à Liège lors de l’exposition de 1979[15].

Illustration 5
Gérard Douffet, La visite du pape Nicolas V au tombeau de saint François d’Assise
Munich, Alte Pinakothek.

Illustration 6
Le Portrait d’homme à la barbe rousse de Gérard Douffet figure au bout du rang supérieur gauche (chapeau haut de forme), sur la même ligne que
le Portrait d’un homme jeune de Velázquez. L’autre Portrait d’homme se trouve dans le rang supérieur droit, au milieu.

Illustration 7
Diego Velázquez, Portrait d’un homme jeune, 1623-1629 ou 1630.
Munich, Alte Pinakothek.
Paradoxalement, on reproduit cette toile, qui était voisine du Portrait d’homme à la barbe rousse de Douffet dans la Galerie Electorale, à défaut de pouvoir montrer ce dernier.
Bertholet Flémalle reçoit un bien moindre traitement que Douffet dans le Catalogue Electoral, avec une seule œuvre : un Jésus-Christ mort, pleuré par les anges (n° 71). La notice tient en un peu plus d’une demi-douzaine de lignes, dont la dernière souligne en tout cas une inflexion française caractéristique : « Ce Tableau est traité dans le style du Poussin. » Comme le résumait bien J. Hendrick, la comparaison avec Douffet, à propos de leur traitement respectif de l’Invention de la sainte Croix, est frappante[16]. D’un côté, chez le premier, « le caractère réaliste, presque plébéien du personnage principal, l’impératrice Hélène », tranche avec la représentation de celle-ci « sous les traits d’une femme jeune encore, au profil pur, à peine individualisé » de la toile conservée à l’église Sainte-Croix. Chez Douffet, des hommes aux « type robustes et inspirés directement de la vie » ; chez Flémalle, « des figures nobles et élégantes » : « son esprit raisonneur diffère de celui plus spontanée de Douffet ». En somme, l’effervescence déréglée de la Renaissance tardive a cédé devant la discipline et la modération de l’ordre pré-classique : Descartes en philosophie, l’hôtel de Rambouillet, l’Académie française et Vaugelas en matière d’expression verbale sont passés par là. S’y ajoute une prolifération des anges, en la représentation desquels « Flémalle excellait » : dans Jésus-Christ mort, commente la notice, « un Ange lui soutient la tête », « un autre à genoux vers ses pieds est plongé dans la plus profonde tristesse », « derrière le tombeau on voit deux autres Anges occupés à élever la croix en l’air ». Autant de témoignages, note J. Hendrick, « d’aspirations idéalistes étrangères aux préoccupations de Douffet ». « Bartholet Flemael » montre l’affirmation d’un « tempérament plus fin, plus raffiné » : le paradigme d’une nouvelle époque.
« Gerard Lairesse », élève de Flémalle, le dépasse en principe dans le Catalogue Electoral comme aux yeux de tel critique moderne — ne craignons pas de donner dans la hiérarchie :
Gérard de Lairesse est, en effet, le peintre de l’école liégeois du siècle dont le renom a eu le plus de retentissement à l’étranger. De tous ces artistes, il était le plus naturellement doué ; aucun d’entre eux ne témoigna de dispositions aussi précoces ; il était, en quelque sorte, un jeune prodige doté d’une facilité d’invention, de composition peu commune[17].
Le catalogue enregistre trois peintures attribuées à Lairesse, avec la meilleure appréciation. Deux d’entre elles font partie des œuvres consacrées à l’Odyssée. Elles sont aussi conservées à l’Alte Pinakothek de Munich. Aucune n’avait pu être présentée lors de l’exposition de 1975 sur Le siècle de Louis XIV, à la différence des deux toiles du Rijksmuseum ayant pour sujets Ulysse et Calypso[18]. La première œuvre exposée à Düsseldorf y est intitulée Ulysse de retour à Ithaque (n° 37). Elle porte aujourd’hui les titres de Minerve veille à la toilette d’Ulysse de retour à Ithaque ou plus simplement d’Ulysse et Pénélope[19]. La notice la décrit brièvement :
Ulysse de retour chez lui, et reconnu de Pénélope sa femme et de ses compagnes, prend le bain : Minerve enveloppée de nuages lui donne un nouvel éclat de beauté et de bonne mine, tandis qu’Eurynome, une des femmes du Palais le parfume, et que plusieurs autres s’empressent à lui apporter les beaux habits, qu’il doit mettre au sortir du bain.
L’élément le plus significatif du commentaire littéraire réside peut-être dans la référence au « sujet tiré du 23e livre de l’Odyssée d’Homère » dans la mesure où, comme le souligne Alain Roy dans son magnifique ouvrage sur l’artiste, « la fidélité de Lairesse au texte d’Homère est très étonnante et témoigne de ce souci constant de l’artiste de mettre son art au service des grands auteurs de l’Antiquité ». Ainsi, le peintre montre exactement comment Athéna « répandit la grâce sur la tête et les épaules d’Ulysse », tout en arrangeant sur celle-ci « des cheveux en boucles », ainsi que dans le texte de l’Odyssée. De même, les préparatifs ordonnés par le héros, en l’honneur de Pénélope, « sont illustrés au second plan de la composition, où, dans une grande galerie décorée de statues, les personnages courent et dansent au son de la lyre d’un aède ».

Illustration 8
Gérard de Lairesse, Minerve veille à la toilette d’Ulysse de retour à Ithaque.
Munich, Alte Pinakothek – Cliché : A. Roy, P. 20.
« Tel est », conclut pour sa part le catalogue de 1778, « le sujet et moment de ce Tableau, où l’on trouve plusieurs beautés de détail : l’architecture y est merveilleusement traitée ». Pour sa part, A. Roy met surtout en évidence, à côté d’une « vigueur du traitement des anatomies » où l’on retrouve une caractéristique de Douffet, « la perspective accentuée de l’architecture », éléments qui suggèrent une datation de l’œuvre entre 1665 et 1668.
Anne-Sophie Brisbois traite de Minerve veille à la toilette d’Ulyssse dans son excellente Etude de l’expression des passions à travers l’œuvre picturale et le Groot Schilderboek de Gérard de Lairesse (1640-1711)[20]. Elle associe à « l’amour pour l’architecture classique qui ennoblit ses compositions », héritage « de son apprentissage liégeois », une utilisation personnelle de la sculpture.
Peuplant ses décors architecturaux, les korês et autres belles antiques, à l’abri d’une niche ou trônant sur un piédestal, sont les témoins imperturbables du drame illustré. Dotées d’une présence presque humaine, elles constituent un élément caractéristique et révélateur de son style. Il s’agit selon nous d’un point sensible du dispositif expressif.
« Leur attitude, rarement innocente », constituerait donc de façon générale un « écho à peine dissimulé aux sentiments évoqués dans l’épisode représenté ». Il est vrai que leur fonction peut se réduire à celle d’un « simple témoin », comme dans Minerve veille à la toilette d’Ulysse, à la différence d’autres toiles où les statues « se changent en intercesseur avec le public auquel elles suggèrent discrètement l’émotion mise en scène » (Antioche et Stratonice, Le banquet de Cléopâtre, La mort de Cléopâtre)[21].
La seconde œuvre inspirée par l’Odyssée forme le pendant de la précédente. Elle s’intitule ici Ulysse se faisant lier au mat (n° 38) et aujourd’hui Ulysse et les sirènes[22]. Elle aurait été réalisée plusieurs années avant Minerve veille à la toilette d’Ulysse, ce qui expliquerait selon A. Roy les « maladresses » de l’ouvrage : « lourdeur des personnages, raideur de leurs gestes », « aspect théâtral et artificiel du paysage ». La notice de 1778 n’éprouve pas de ces réticences envers un tableau montrant comment « Ulysse, avant de s’engager dans les écueils de Craybde et de Sylla, et pour évter le charme des Sirènes », suit « les conseils de Civée, en se faisant lier au mât de son vaisseau, et en faisant boucher les oreilles à ses compagnons », qui « rament de toute leur force pour sortir de ce lieu dangereux ». « Cette composition répond parfaitement à la beauté du sujet, qui est rendu avec beaucoup de graces. » Mais peut-être la manière dont elle s’offrait aux regards des visiteurs spadois des Lumières n’était-elle pas la même qu’aujourd’hui : A. Roy impute éventuellement les défauts de l’œuvre à son « mauvais état de conservation ». En tout état de cause, la reproduction de la peinture dans le catalogue — comme la gravure de Glauber tirée de celle-ci — montre le groupe de gauche, avec le vaisseau d’Ulysse, nettement plus clair et net que dans la reproduction photographique de l’ouvrage d’A. Roy, au point que l’auteur de la première paraît discerner, près du navire, dans le coin inférieur gauche, un personnage immergé, alors que la gravure s’interroge manifestement sur le sens de ce détail (voir les illustrations 10-11).

Illustration 9
Gérard de Lairesse, Ulysse et les sirènes.
Munich, Alte Pinakothek – Cliché : A. Roy, P. 19.

Illustration 10
Gravure d’après le tableau précédent.
Cliché : A. Roy, 19a.

Illustration 11
Gérard de Lairesse, Ulysse et les sirènes.
Le tableau est le dernier de la deuxième rangée, à gauche.
Une troisième œuvre attribuée à Lairesse figure au catalogue sous le n° 73 (illustration 12). Il s’agit d’un tableau intitulé L’adoration des bergers, auquel l’ouvrage d’A. Roy consacre la notice suivante :
Bien qu’exposé depuis le milieu du XVIIIe siècle sous le nom de Lairesse dans la galerie du Prince-Electeur de Düsseldorf, ce tableau ne nous semble pas de la main de l’artiste. La date même portée sur la toile, qui commence par 17.., rend l’attribution impossible, de même que des raisons purement stylistiques. Le nom de Nicolaes Verkolje (1646-1746) a été proposé dans la documentation du R.K.D. de La Haye, mais nous croyons davantage à l’œuvre d’un artiste comme Ottmar Elliger le jeune (Hambourg, 1666-Saint-Petersbourg, 1735)…

Illustration 12
Adoration des bergers faussement attribuée à Gérard de Lairesse.
Munich, Alte Pinakothek – Cliché : A. Roy, P.R. 58.
Le catalogue jugeait l’œuvre « d’une belle composition », avec « beaucoup de naïveté dans l’expression ». Mais il est exact que les personnages, et notamment la Vierge, n’offrent pas le caractère de « vérisme » et de force expressive qu’on trouve chez Lairesse et, plus généralement même, dans les Adorations de bergers des autres peintres liégeois, y compris chez Bertholet Flémalle.
Il ne resterait guère, après cela, qu’à reproduire les dernières lignes de l’Introduction d’A. Roy :
Qu’il nous soit permis afin d’exprimer le souhait qui est sans doute celui qu’émet tout auteur de monographie d’un artiste oublié : qu’une exposition de caractère international qui associerait Liège, Amsterdam et Paris, vienne couronner et compléter ce travail. (…) Alors, celui que l’on a parfois surnommé le Poussin hollandais » se révélerait probablement comme l’un des artistes les plus attachants de la seconde moitié du XVIIe siècle européen.
Qu’il soit permis de prolonger ce souhait par un autre, qui concerne la Galerie Electorale et plus modestement l’histoire de Spa : on aimerait que soit complétée la liste des bobelins ayant accompli le voyage de Düsseldorf, spécialement dans les rangs des artistes et des écrivains. On a évoqué ailleurs[23] ceux qui, venus de France, de Lorraine ou de Suisse, séjournèrent dans la ville d’eaux au XVIIIe siècle. Parmi eux figure notamment Fragonard.
*
Madame Sophie Raux, que l’on suivra ici pour l’essentiel[24], a souligné qu’il est « peu d’artistes » qui eurent comme Fragonard « l’opportunité d’étudier de visu autant de compositions différentes, dispersées dans autant de villes européennes et à plusieurs étapes de leur carrière ». « Conçue comme une artistique à part entière », la reproduction des chefs-d’œuvre du passé fut pratiquée « pour la satisfaction d’amateurs » : « à plusieurs reprises, Fragonard fut invité à accompagner de riches mécènes au cours de leur voyage, afin de leur servir de guide et de dessiner à leur intention toutes les compositions qui retenaient leur attention, dans les églises, les palais et les collections visitées. Il effectua ainsi deux voyages en Italie, dont celui accompli à partir d’octobre 1773, pendant près d’un an, est suffisamment documenté par le récit qui en subsiste.
L’abondance de ses reproductions d’œuvres flamandes et hollandaises du Siècle d’Or a imposé l’hypothèse d’un voyage dans les pays où elles se trouvaient exposées. Mais sur ces visites, écrit S. Raux, on n’a su, pendant longtemps, « quasiment rien ». Alexandre Ananof, « le premier à avoir consacré un article entier à la question du voyage de Fragonard dans les Pays », rappela d’abord les dates proposées[25] : entre 1761, après le premier séjour en Italie, et 1769 (selon Pierre de Nolhac) ; en 1766, en accompagnement de Boucher aux Pays-Bas, ou « vers 1775 », après le second voyage en Italie (Louis Réau) . Enfin A. Ananof lui-même proposait de situer « entre 1772 et 1773 » un voyage accompli en compagnie de l’amateur Pierre Jacques Onésime Bergeret, seigneur de Grancourt. Celui-ci, membre d’une importante famille de financiers, était receveur général des Finances de la généralité de Montauban puis de Paris — titres auxquels correspondait une « fortune considérable » héritée de son père. Mais cette datation, avec laquelle vont relativement s’accorder celle consacrée par S. Raux en 2007 et celle apportée par les documents spadois, ne s’imposa pas unanimement. Madame Anne Dupuy-Vachey, la spécialiste de Fragonard, le rappelait en juillet 2012, dans un autre article essentiel pour notre propos[26] : Jean Montagu Massengale proposait encore en 1979 de situer le voyage dans le Nord en 1769 ; Pierre Rosenberg distinguait en 1987 au moins deux séjours, dont le second se serait situé vers 1772 ; Jean-Pierre Cuzin le plaçait au même moment « entre 1775 et 1776 », pour revenir « en 2004 à une datation plus précoce entre 1765 et 1772 ».
On en était donc encore, naguère, à une relative incertitude concernant la date du voyage en Italie. Après A. Ananoff, S. Raux remet en évidence un passage du Journal et le soumet à une lecture qui « permet de situer approximativement ce périple dans le Nord ». La formulation est en effet très suggestive.
Le jour du départ pour l’Italie, le 5 octobre 1773, Bergeret écrit d’Orléans : « Je n’étois pas encore rouillé du train d’auberge depuis la Hollande et l’Allemagne, et je l’ai repris facilement et avec plaisir ». Ce qui permet de déduire aisément que ce voyage dans le Nord a précédé de peu celui qu’il a entrepris en Italie et a conduit la plupart des chercheurs à le situer trop hâtivement en 1772.
Le rapprochement avec le mois d’octobre 1773 s’est également resserré dans la mesure où Fragonard, comme le remarque la même historienne, se trouvait à Paris, « au moins jusqu’à la fin mars 1773 », « pour la commande royale des travaux de Bellevue ». Un nouvel élément, décisif, est apporté par un dessin reproduisant La Crucifixion de Van Dyck, « exécuté d’après le tableau qui se trouvait à l’église des Récollets de Malines », aujourd’hui à la cathédrale de la même ville. Au verso se lit une inscription, de l’écriture de Bergeret, « qu’Ananoff n’avait pas vue[27] ». Elle atteste que les deux voyageurs set trouvaient dans les Flandres en juillet 1773.
A. Ananoff avait par ailleurs attiré l’attention sur un autre passage du Journal d’Italie. Alors que les deux hommes se trouvaient alors à Venise, en juillet 1774, Bergeret se souvient de son « voyage de Flandre » en expliquant qu’il avait commencé celui-ci « par les grandes villes » — « Bruxelles, Anvers, etc. » — pour se transporter ensuite « dans d’autres petites villes de Flandre », où les visites furent décevantes. Ainsi suivit-il le conseil, « pour mieux employer [son] temps et [son] argent, d’entreprendre d’aller voir les belles galeries de Düsseldorf sur le Rhin ». Rappeler cette dernière information, c’est dire à quel point la visite à la Galerie Électorale fait partie, depuis longtemps, des données concernant le « voyage dans le Nord ». S. Raux intitule dès lors une section de son étude « De Bruxelles à Düsseldorf », où elle reconstitue l’itinéraire suivant, à partir de juillet 1773 : Bruxelles, Malines, Anvers, La Haye, Amsterdam, après quoi « Bergeret et Fragonard ont regagné la France, en passant par Düsseldorf ». Les collections de l’Electeur ont fortement impressionné le premier. S. Raux note : « Il s’en souviendra un an plus tard, lorsqu’il visite les galeries de Offices à Florence, qu’il juge décevantes en comparaison de ce qu’il a vu en Rhénanie. » Un autre aspect de cette étape du voyage de retour doit être souligné :
Curieusement aucun dessin de ce passage à Düsseldorf, qui a tant enchanté Bergeret, ne nous est parvenu. Une explication peut être avancée grâce au témoignage de Reynolds. Lors que ce dernier visite les galeries de Düsseldorf en 1781, il relate dans son journal que le Prince-Electeur s’est d’abord longtemps refusé à permettre que l’on y puisse copier ses œuvres, crainte que les copies circulant sur le marché ne déprécient la valeur de ses tableaux.
Telle était la connaissance qu’avaient les spécialistes du voyage de l’été 1773, avant qu’une information produite par Madame Melissa Percival, dûment relevée par Anne Dupuy-Vachey, n’apporte en 2012 un nouvel élément. Dans son ouvrage Fragonard and the Fantasy Figure. Painting the Imagination, M. Percival discute l’influence exercée par les portraits de Rembrandt sur Fragonard, mais répercute un doute dans la mesure où celle-ci aurait eu lieu avant le voyage dans le Nord, à un moment où Fragonard n’aurait pas encore établi un contact direct avec la production de Rembrandt — tel que l’a aussi favorisé la visite à la Galerie Électorale[28].
En note, M. Percival fait état d’une communication due à Madame Carmen Goetz (Musée d’Histoire de la Médecine de l’Université de Düsseldorf)[29]. Celle-ci se fonde sur un journal local, les Gülich und Bergischen Wöchentlichen Nachrichten (Nouvelles hebdomadaires de Juliers et de Berg), à la date du mardi 31 août 1773 (n° 35). On y lit (je traduis) : « Arrivée de personnalités et voyageurs… quatre Français, N. Bergeres, Maussion, Lubersalle et Fragonard à l’auberge du Zbückerhof. » Dans son compte-rendu de l’ouvrage de M. Percival, A. Dupuy-Vachey répercute l’information tirée de la gazette allemande et propose « sans hésitation de rattacher à ce voyage un dessin de Fragonard montrant des hommes malades dans un bateau et dont les noms inscrits sur la feuille correspondent parfaitement à ceux mentionnés par le chroniqueur ». A. Dupuy-Vachey souligne le double intérêt de « cette petite découverte » : « cette scène était jusqu’alors considérée comme datant du second voyage en Italie de l’artiste » ; « le passage de Fragonard à Düsseldorf n’était jusqu’alors documenté » — comme on l’a vu — « que par une allusion de Bergeret dans son récit de voyage en Italie… ». On reproduit ci-dessous la pièce en question, d’après le compte-rendu.

Illustration 13.
Jean-Honoré Fragonard, Fragonard et ses compagnons de voyagemalades dans un bateau, 1773.
Plume et encore brune, lavis brun, pierre noire – 10,5 x 32, 5 cm.
Collection privée – Photo : D.R.
Dans une étude électronique intitulée « Des exigences de Bergeret aux créations de Fragonard : histoire d’un démêlé entre artiste et commanditaire », Madame Emmanuelle Champion reproduit le même dessin en le référant au premier voyage en Italie de l’artiste[30].
Bergeret arrive le 1er novembre à Marseille. A partir de ce point, il reprend l’itinéraire classique du « Grand Tour » en Italie. D’Antibes, la troupe embarque pour San Remo après avoir attendu des conditions de navigation convenable durant trois jours. Seul Fragonard semble avoir échappé au mal de mer. Un dessin conservé à New-York retrace cet épisode.
La légende du dessin donne cette fois comme légende : « New York, Collection particulière. Cat. Exp. Paris-New York, p. 365, fig. 2 : l’intérieur d’un vaisseau battu par la
tempête où se trouvait Mr Fragonard, Bergeret, Lubersac et Motion. » On voit que se pose décidément la question des personnages figurant dans l’embarcation — ceux qu’E. Champion appelle « les protagonistes du voyage » et qui sont sans doute plutôt les visiteurs de la Galerie de Dusseldorf, comme le suggèrent S. Raux et A. Dupuy-Vachey. On se trouve en somme, aujourd’hui, dans la situation qui était celle de 2007 lorsque S. Raux écrivait : « Nous ignorons, en dehors de Bergeret et de Fragonard, qui d’autre faisait partie du voyage » — c’est-à-dire du voyage de Bruxelles à Düsseldorf — « quels membres de leur entourage, combien de domestiques ».
Les noms mentionnés par les Nouvelles de Juliers et de Berg laissent supposer qu’il s’agissait d’un groupe de quatre personnes. Ce sont ces quatre noms qui figurent sur la Liste des seigneurs et dames venus aux eaux minérales de Spa, l’an 1773, inscrits le 2 septembre au Grand Monarque, « Grande-Place, N° 16 ». Rappelons que cette hôtellerie était l’une des mieux fréquentées de Spa. Elle accueillit en 1764 les comtes Golovkine et Murray, en 1770 l’écrivain Alfieri, en 1774 le baron de Grimm, partenaire de Diderot pour la Correspondance littéraire, etc. L’immeuble a été conservé.
Monsieur « Maussion », cité par le journal, est inscrit à Spa sous le nom de « Monsieur de Mautions de Courtougaes, Receveur-Général des Finances ». Il peut s’agir de deux personnages. Le premier serait Etienne Charles Maussion, seigneur de la Courtaujay ou Courtaujaye (1705-1773), écuyer, conseiller du roi, receveur général des Finances d’Alençon, qui avait épousé le 10 février 1734, à Saint-Eustache, Marie Thérèse Antoinette Bergeret (vers 1714-1778), sœur de Pierre Jacques Onésime (1715-1785), compagnon de voyage de Fragonard[31]. En principe, le second peut être le fils d’Etienne Charles, Etienne Thomas (1750-exécuté en 1793). Dans le premier cas, le père se serait trouvé à Spa avant de mourir la même année. D’un autre côté, son fils lui aurait succédé comme « receveur général des Finances d’Alençon » en 1775, mais il en porta peut-être le titre avant cette date, dès le séjour à Spa[32]. En somme, le patron de Fragonard voyagerait soit avec son beau-frère, de dix ans plus âgé, soit avec le fils de celui-ci, qui avait un peu plus de vingt ans.
Le nom du quatrième membre du voyage à Düsseldorf donne lieu, on l’a vu, à plusieurs noms : « Lubersalle » pour M. Percival, « Monsieur l’Abbé de Luberzot, Grand Vicaire en France » à Spa, ou Lubersac chez E. Champion. Cette dernière forme est la bonne.
Il doit s’agir de Jean Baptiste Joseph de Lubersac, vicaire général d’Arles et aumônier du roi (1740-1822). Sa biographie précise qu’il allait être nommé évêque de Tréguier en 1775 et qu’il sera député du clergé aux États-Généraux de 1789. On imagine le souvenir que devait conserver de l’épisode ce personnage qui retrouva l’Allemagne pendant la Révolution et terminera son existence comme chanoine de Saint-Denis.
 Illustration 14. Illustration 14.
Hôtel du Grand Monarque, où descendent Alfieri (1770), Fragonard (1773), le baron de Grimm (1774), etc. L’établissement conservera son enseigne jusque vers 1890, selon A. Body (cliché M. Collart)
Se pose la question de la rapidité avec laquelle s’effectua un voyage qui permit à Fragonard d’être à Düsseldorf le 31 août et à Spa le 2 septembre. Comme me l’écrit Madame Dupuy-Vachey : « a priori, et d’après ce que je sais par ailleurs de leur rythme de voyage », il ne « semble pas impossible qu’ils aient parcouru ces quelques 120 km en 2 ou 3 jours ». En tout état de cause, « ils ne devaient pas faire beaucoup de tourisme », « sur le chemin du retour ». Stéphane Blond, du Laboratoire d’histoire économique, sociale et des techniques de l’Université d’Evry-Val d’Essonne, a mis à contribution sa connaissance du célèbre Itinéraire de Louis Dutens (1ère éd. 1775) pour calculer le temps requis par ce voyage[33]. En fonction du parcours qui semble le plus approprié, le trajet de Düsseldorf à Cologne aurait pu prendre environ onze heures, celui de cette dernière ville à Aix-la-Chapelle un peu moins de cinq heures et celui d’Aix-la-Chapelle à Spa six heures et demie, soit un total d’à peu près vingt-deux heures. Paraissent s’imposer un nuitée à Cologne, à mi-chemin, et l’arrêt le plus bref possible à Aix-la-Chapelle.
Quel intérêt offrait une visite de Liège, pour Fragonard et son mécène ? La peinture est presque totalement absente de ce qu’apprend le guide de voyage par excellence au XVIIIe siècle, le Grand Tour de Thomas Nugent, concernant la capitale principautaire[34]. Seuls les « ornements en marbre et en peinture » de l’église Saint-Paul sont signalés. L’attention se concentre sur « la magnificence des édifices publics » et les richesses qu’offrent les établissements religieux : « trésor » de la cathédrale, « buste de saint Lambert finement exécuté en argent », « saint George à cheval en or massif », offert aux Liégeois « par Charles le Téméraire en repentir de les avoir traités cruellement en 1468 », etc.[35]. Mais le guide fournit opportunément des indications sur la manière de rallier les grands centres artistiques des pays voisins. De Liège, d’une façon générale, des bateaux et des voitures vont « vers toutes les villes voisines aussi bien qu’en Allemagne et dans les Pays-Bas ». « Vers Spa en particulier, il y a une voiture qui part tous les matins ; mais la route est très désagréable ». Et des bateaux vont chaque jour à Maastricht, « qui n’est distante que de quinze miles » (environ 25 km). De cette dernière ville, « des voitures, appelées diligences », partent quotidiennement vers Aix-la-Chapelle ou Bruxelles, et vont « même à Cologne en un jour[36] ». Le conseil paraît clair. Pour au moins se faire une première idée de la peinture liégeoise contemporaine — quitte à mélanger le vrai Lairesse avec le faux — n’hésitez pas à prendre le chemin de l’étranger.
*
On n’abordera pas ici, pour esquisser un bouquet final, la question des autres artistes et écrivains qu’attira la collection électorale. Joshua Reynolds, en 1781, fut l’un d’eux[37]. Montesquieu l’avait vue. Dans ses Pensées détachées sur la peinture, la sculpture, l’architecture et la poésie ; pour servir de suite aux Salons, Diderot écrit notamment : « J’ai vu à Dusseldorf le Saltimbanque de Gérard Dou[38]… » Raymond Trousson situe la visite du philosophe à la Galerie aux environs du 24 août 1773, soit une semaine avant Fragonard[39]. Mais l’article des Gülich und Bergischen Wöchentlichen Nachrichten du 31 août renvoie nécessairement à un fait antérieur d’un ou de plusieurs jours : il s’agit, comme l’indique bien le titre, de Nouvelles hebdomadaires.
Par ailleurs, on serait évidemment intéressé de savoir dans quelles conditions pratiques de voyage et d’accueil s’est effectuée la visite de Diderot. Quelles étaient les meilleures modalités de parcours pour se rendre de La Haye à Duisbourg en passant par Dusseldorf ? Quel accueil l’écrivain pouvait-il trouver auprès de l’Electeur Charles Théodore, que l’on dit amateur des arts, et notamment du théâtre, mais qui s’était attaché un homme peu ami des philosophes, Cosimo Alessandro Colini ? Celui-ci était connu pour ses relations difficiles avec Voltaire — ou Madame Denis. Vergennes le tenait en piètre estime[40].
L’enquête sur les « bobelins » de Spa conduit largement à des questions d’histoire de l’art et de la littérature sous-tendues par le réseau des échanges internationaux et des relations cordiales. Le dossier n’est qu’entrouvert[41].
NOTES

[1] La comtesse de Sabran et le chevalier de Boufflers. Le lit bleu. Correspondance. 1777-1785. Ed. établie et présentée par Sue Carrell. Paris : Tallandier. 2009 (La bibliothèque d’Evelyne Lever), p. 219. On adopte la datation proposée par l’éditrice. La période spadoise des amours des deux personnages est peu présente, faute de connaissance de la correspondance, dans l’ouvrage de Joseph M. Callewaert : La comtesse de Sabran et le chevalier de Boufflers. Paris : Perrin. 1990. Voir aussi : Le livre d’or de Spa. Le tableau d’Antoine Fontaine. Notices de Marie-Christine Schils, introduction de Jean Toussaint, Spa : Editions du Musée de la Ville d’Eaux, 2006, p. 48. Je remercie M. Collart de l’aide apportée à la préparation de cette ébauche d’étude.
[2] Voir la première lettre du chevalier à son amie, de mai ou juin 1777 : Corr., p. 45.
[3] Corr., p. 209-210.
[4] Alexandre Stroev, courriel du 6 janvier 2013 : voir les Archives du Ministère des Affaires étrangères, Contrôle des étrangers, vol. 41. Je remercie vivement A. Stroev, collaborateur de la Société wallonne d’étude du dix-huitième siècle, des informations régulières qu’il nous communique concernant les hôtes de Spa.
[5] Corr., p. 220.
[6] Display Art History. The Düsseldorf Gallery and Its Catalogue. The Getty Research Institute, s.d.
[7] P. 1-51.
[8] Pour la comparaison des copies de L’Elévation de la Croix par Carl Ernst Christoph Hess et Jean-Victor Frédou de La Bretonnière, voir p. 72-73, dans la section de l’ouvrage intitulée The Düsseldorf Gallery and the End of the Galeriewerk Tradition, par Louis Marchesano. Sur la copie de l’Assomption de Reni, voir p. 79.
[9] P. 16-31.
[10] P. 32-33.
[11] Laveaux entretint par ailleurs des rapports assez étroits avec des académiciens de Berlin. On l’associe (?) à l’édition de l’Extrait du Dictionnaire historique et critique de Bayle publié par Frédéric II, le marquis d’Argens et Dieudonné Thiébault en 1765. Il devait en tout cas devenir singulièrement familier de l’institution prussienne pour donner, à une date indéterminée, mais peut-être en 1789, une Frédéric II, Voltaire, Jean-Jacques, d’Alemberte et l’Académie de Berlin vengés du secrétaire perpétuel de cette académie.
[12] P. 34 sv.
[13] Jacques Hendrick, La peinture liégeoise au XVIIe siècle. Gembloux : Duculot, p. 19. « On a violemment reproché aux membres du clergé liégeois d’avoir accepté de vendre des tableaux qui étaient le principal ornement de leurs églises et pourtant, quand on connaît le sort qui fut réservé à la majorité des autres œuvres importantes de Douffet , on doit plutôt se réjouir qu’elles aient trouvé refuge dans ces musées » - c’est-à-dire en Allemagne. Voir aussi : Pierre-Yves Kairis, « Le peintre Gérard Douffet, fondateur de l'école liégeoise du XVIIe siècle ». Bull. de la Classe des Beaux-Arts, Acad. roy. de Belgique, 5e série,70, 1988, p. 40-54 ; Le syndrome Picasso : un pouvoir public peut-il vendre une œuvre d’art appartenant à son patrimoine. Le cas liégeois/ Liège, Académie royale des Beaux-Arts. Crisnée : Yellow Now, 1990 ; « Douffet, Gérard », Belgian Art Links and Tools (BALaT),
http://balat.kikirpa.be/Detail_notice.php?id=2065.
[14] « Rubens et la peinture liégeoise au XVIIe siècle », communication prononcée le 31 mai 1946 ; Chronique archéologique du pays de Liège 37e année , n° 1-4, janvier-déc. 1946.
[15] Cat., n° 295.
[16] Cat. de l’exposition de 1979, notice 315.
[17] J. Hendrick, La peinture liégeoise, p. 49.
[18] N° 357 et 359 ; Roy, indices P. 138 et P. 139, p. 299-300.
[19] Roy, indice P. 20, p. 205-206
[20] Mémoire de licence en Histoire de l’art et archéologie, Université de Liège, 2007, p. 58-59 : Les statues, un élément décoratif qui participe à l’expression des passions.
[21] Au reste, « dans son Grand livre des peintres, Lairesse attribue à ces statues intégrée à l’architecture une fonction similaire aux figures représentées dans un paysage ».
[22] Roy, p. 204-205, indice P. 19.
[23] « Spa au XVIIIe siècle : Les chemins croisés de l’écriture ». Communication présentée à l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique à la séance mensuelle du 8 décembre 2012. En ligne :
http://www.arllfb.be/ebibliotheque/communications/droixhe08122012.pdf.
« Id.. », L’Avant-Coureur spadois, n° 6. En ligne :
http://www.swedhs.org/visiteurs/avantcoureurspadois/cheminscroises.html.
Voir les actes, à paraître, du colloque international sur « Spa, carrefour des Lumières. Les hôtes de la cité thermale au XVIIIe siècle » (Spa, 25-26 septembre 2012 ; M. Collart et D. Droixhe).
[24] « Le voyage de Fragonard et Bergeret en Flandre et en Hollande durant l’été 1773 », Rue de l’art 156/2, 2007, p. 11-28.
[25] « La réalité du voyage de Fragonard aux Pays-Bas », Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français, 1959, p. 7-17.
[26] “Compte rendu de M. Percival, Fragonard and the Fantasy Figure. Painting the Imagination ». Tribune de l’art, 19 juillet 2012 - http://www.latribunedelart.com/fragonard-and-the-fantasy-figure-painting-the-imagination.
[27] Ibid., p. 18.
[28] Farnharm (Surrey) : Ashgate Publishing, 2012, p. 62. Mais l’argument est contesté en raison des « amples possibilités » dont disposait Fragonard de voir en France le travail du Hollandais, notamment par les reproductions.
[29] Inid., p. 86, note 36.
[30] Merci à M. Collart de me l’avoir communiqué.
[31] Voir « La famille Bergeret de l’Isle-Adam et de Frouville (Seine-et-Oise) ». Mémoires de la Société historique et archéologique de l’arrondissement de Pontoise et du Vexin 42, 1933, p. 78-79. Communication M. Collart.
[32] La même année, ce jeune homme qui « jouissait de plus de soixante mille livres de revenu » épousait une demoiselle de Cypierre. Voir A. Bouvier, « La société orléanaise de 1760 à 1790 », 5e série, t. 13, 1913, p. 261-262, qui écrit qu’Etienne Thomas fut « nommé, cette année même [1775], maître des requêtes, plus tard intendant à Rouen ». Le titre de « maîtres des requêtes » paraît lié à celui de « receveur général des Finances ».
[33] Courriel du 3 déc. 2012.
[34] The Grand Tour : a journey through the Netherlands, Germany, Italy and France. London : J. Revington, 1778 ; With an introd. By R. Mayhew. London : Ganesha, 2004 (fac. sim de la 2°éd. de 1756), t. I, p. 257-60.
[35] The Grand Tour : a journey through the Netherlands, Germany, Italy and France. London : J. Revington, 1778 ; With an introd. By R. Mayhew. London : Ganesha, 2004 (fac. sim de la 2°éd. de 1756), t. I, p. 257-60.
[36] Ibid., p. 268.
[37] Voir J. Reynolds, A Journey to Flanders and Holland. London, 1781. Ed. by By Harry Mount. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996.
[38] Salons I. Héros et martyrs. Salons de 1769, 1771, 1775, 1781. Pensées détachées sur la peinture. Texte établi et présenté par Else Marie Bukdahl, Annette Lorenceau, Gita May. Paris : Hermann, 1995, p. 440 ; Salons. Textes choisi, présentés, établis et annotés par Michel Delon, Paris : Gallimard, 2008, p. 469 (Coll. Folio Classique).
[39] Diderot jour après jour. Paris : H. Champion, 2006 ; courriel du 7/02/2013. Voir Guillaume Glorieux, « Les artistes et le goût », Relire les « Pensées détachées sur la peinture… » de Denis Diderot. Célébration nationale du tricentenaire de la naissance de Denis Diderot. 5/6 février 2013. Université de Rennes 2 / Musée des Beaux-Arts de la ville de Rennes.
[40] Voir Jörg Kreutz: Cosimo Alessandro Collini (1727–1806). Ein europäischer Aufklärer am kurpfälzischen Hof. Mannheimer Altertumsverein von 1859 – Gesellschaft d. Freunde Mannheims u. d. ehemaligen Kurpfalz; Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim; Stadtarchiv — Institut f. Stadtgeschichte Mannheim (Hrsg.). Mannheimer historische Schriften Bd. 3, Verlag Regionalkultur, 2009.
[41] On laisse ici de côté les références, chez Diderot, via Hagedorn, au Liégeois Gérard de Lairesse et à son très peu national Groot schilderboek, un ouvrage-phare de l’âge classique et des Lumières. On aimerait savoir quelle édition a utilisée Diderot. La traduction française courante ne date que de 1787. | |



|


















